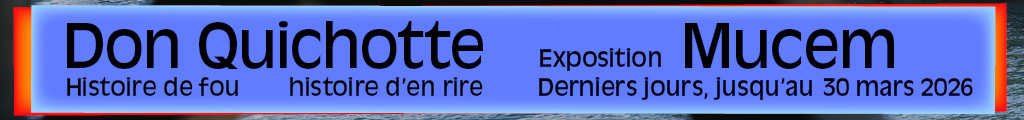Zébuline. Pourquoi avez-vous décidé de travailler sur cette parole-là ?
Julie Berès. À l’époque de la création de la pièce [en 2018, ndlr], les médias parlaient beaucoup de la radicalisation des jeunes filles issues de milieux relativement défavorisés. Il y avait un phénomène de stigmatisation qui touchait particulièrement cette catégorie sociale. On a voulu comprendre cette expression de colère. Les jeunes filles que nous avons rencontrées nous disaient que c’était surtout une réaction à une société qui n’accueillait pas leurs révoltes et leurs questionnements, à une époque qui ne cesse de se renforcer dans son capitalisme et dans laquelle elles ne voyaient pas d’épanouissement possible. Elles ne savaient pas quoi faire de cette colère, alors elles se faisaient récupérer. Mais je ne voulais pas seulement questionnercette forme de réaction. On s’est donc demandé plus largement comment faisaient ces jeunes femmes pour faire entendre leur voix dans une société où elles subissent à la fois le racisme, la misogynie, et le poids de la tradition.

Comment avez-vous conçu la pièce ?
J’ai d’abord rencontré une quarantaine de jeunes femmes. Certaines revenaient de Syrie, certaines vivaient en banlieue, certaines étaient artistes. On a finalement décidé de s’intéresser à ces quatre femmes passionnées par les arts, qui avaient dû se battre pour assumer de dire « je ferai de la danse, même si tu considères que cen’est pas un métier ».
Il y a ensuite eu un long travail d’écriture, d’allers-retours avec le plateau, pour inventer une forme performative, de par la présence de la danse et du chant, mais surtout d’un rapport très direct au jeu, à la langue et aux propos.
Comment cela se présente dans le texte ?
Avec Kevin Keiss et Alice Zeniter [les co-auteur·ices, ndlr], nous avons cherché à donner au public l’impression de la confidence, de l’immédiateté, alors que tout est écrit à la virgule près et que la pensée politique est maîtrisée.
On a créé des situations de dialogue et de désaccord entre elles pour trouver l’endroit des paradoxes, de la contradiction, de l’humour, sans asséner un discours qui serait la pensée des auteurs. L’objectif était de montrer à quel point elles peuvent être paradoxales, à la fois dans la nostalgie de certaines choses qu’elles ont pu recevoir dans leur éducation et dans le rejet. Elles font entendre tous les conflits intérieurs qui naissent de cette ambivalence, sans nécessairement être dans une forme de narration.
Et sans pessimisme ?
Non. C’est une pièce pleine d’énergie, de joie et de surprises. Et c’est un hymne à la liberté. On voit souvent la désobéissance comme une chose négative, alors qu’elle est absolument nécessaire pour la construction de l’être.
Cette joie, c’est ce que vous cherchez à exprimer ?
Oui. Je cherche à faire un théâtre qui puisse armer la conscience, mais aussi armer à l’espoir et à la joie. Surtout quand on touche à des sujets politiques complexes et délicats, c’est important de ne pas asséner une pensée pessimiste et uniquement de dénonciation. D’autres s’en chargent.
PROPOS RECUILLIS PAR CHLOÉ MACAIRE
Désobéir
Du 24 au 27 avril
La Criée, théâtre national de Marseille
Retrouvez nos articles Scènes ici et Rencontres ici