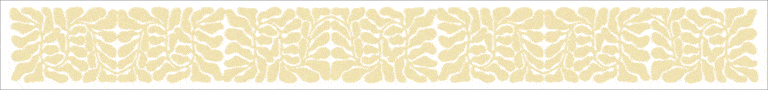Borders and walls
Les limites. Dernier opus en date de la Compagnie Carré Blanc, Borders and Walls interroge le territoire créatif et ses frontières. Au rythme de pulsations électro savamment disséminées, concoctées par Marin Bonazzi, les corps se mêlent, se testent, se rencontrent. La chorégraphe Michèle Dhallu a réuni pour ce spectacle pensé en premier lieu à destination d’adolescents, des danseurs – formidables Zoé Boutoille et Bryan Montarou – des acrobates – Timothée Meiffren et Jihun Kim – et même des profils au croisement de ces deux disciplines – étonnante Yane Corfa. Le langage chorégraphique, considérablement enrichi, se déploie dans une grande joie et avec générosité. Une fois évacuées les chaussures, obstacle le plus évident à la fluidité de mouvement, les échanges se font musclés, gracieux. Les danseurs se heurtent, s’imitent, vont chercher leurs pas du côté du jazz, du cirque, du hip-hop… Les murs qui se dresseront peu à peu face à ces jeunes êtres en devenir ne sont finalement que ceux qu’ils s’imposent à eux-mêmes. La peur du saut constituant la première réelle entrave aux envols en tous genres. Cette ode à la liberté, un brin naïve, ne manque heureusement ni de subtilité ni d’humour.
Borders and walls a été joué du 7 au 28 juillet à LaScierie, à Avignon.
Looking for Quichotte
Les moulins de son cœur. Voilà dix ans que le Montpelliérain Charles-Éric Petit a fait prendre quelques couleurs au célèbre chevalier à la triste figure. Son Looking for Quichotte a déjà fait l’objet de deux mises en scène, par Vladimir Steyaert et Pascal Frery. Mais c’est sous sa propre direction que son texte, sélectionné par la Comédie-Française en 2017, s’est vu de nouveau porté à la scène au Théâtre des Carmes. Et grand bien en a pris à l’auteur-metteur en scène de s’en réemparer : son chevalier-rocker – fringant Thomas Cerisola – y gagne un ton particulièrement juste. Côté chansons, entonnées avec entrain, mais également et surtout dans sa caractérisation à la fois comique et inquiète. Face à lui, le très ancré Sancho Panza de Franck Gazal se fait de moins en moins ingénu : son maître, plus aguerri que quiconque pour pourfendre les grandes enseignes de restauration rapide ou candidater au RSA, perdant successivement pied. Le tout pourra sembler encore un peu étiré dans le temps : mais le duo demeure redoutablement attachant.
Looking for Quichotte a été joué du 7 au 26 juillet au Théâtre des Carmes, à Avignon.
Les Poupées

Jeu de môme. Nombreuses sont les pièces chorégraphiques prenant pour sujet les arts plastiques. Fresques animées, tableaux agencés comme des toiles, au mouvement millimétré… Plus rares sont celles qui s’intéressent à l’acte de création même : à sa technicité, ses matériaux, son imaginaire. C’est ce sillon que Les Poupées creuse avec délicatesse et poésie. Conçu comme un hommage à l’œuvre de Michel Nedjar, l’opus de Marine Mane joue avec les idées, les images et les mots. Le geste chorégraphique et la scénographie s’approprient les collages, les jeux de composition et de décomposition de l’artiste. Jusqu’à faire sien le « coudrage » cher au plasticien, mêlant le principe de la couture à celui du montage. Les pas de Claire Malchrowicz accompagnent, illustrent les paroles du comédien Vincent Fortemps, puisées dans le très beau Chantier des consolations,publié par Michel Nedjar en 2017. Tandis que les poupées, maniées, démembrées, consolées par les interprètes, prennent vie.
Les Poupées a été joué du 7 au 26 juillet à la Caserne des pompiers, Avignon.
L’Art de perdre

Qui perd gagne. Grand succès critique et public lors de sa publication en 2017, L’Art de perdre d’Alice Zeniter aura fait l’objet de non pas une, mais bien deux adaptations théâtrales au seul festival Off d’Avignon 2022. La première d’entre elles, mise en scène par Sabrina Kouroughli, fut jouée au 11·Avignon en matinée, et la seconde par le collectif Filigrane 111, à l’Entrepôt. Cette dernière fit l’objet d’une concertation soutenue avec l’auteure : avec la comédienne Céline Dupuis, adoubée par Zeniter, qui endosse tous les rôles ; et avec le metteur en scène Cyril Brisse, avec qui la comédienne a pensé l’adaptation, qui lui donne la réplique et fait dialoguer la voix de la comédienne avec différents médias. À l’écran se succèdent des paysages de l’Algérie perdue, des extraits enregistrés par des acteurs sous forme de témoignage. Le tout ancre la fiction dans un format documentaire, joliment travaillé par le réalisateur Franck Renaud qui avait déjà, avec Makach Mouchkil, tourné sa caméra vers ces terres si méconnues et leurs interférences avec notre histoire. L’immersion est, notamment grâce au son très travaillé de Yannick Donet, totale. Quitte à sacrifier un peu de lisibilité de l’action et de ses enjeux matériels sur l’autel de la langue, qui se révèle dans toute sa complexité.L’Art de perdre a été joué du 7 au 30 juillet au théâtre de l’Entrepôt.
L’Art de perdre a été joué du 7 au 30 juillet au théâtre de l’Entrepôt.
Music-hall

Bye bye happiness. « Ne me dis pas que tu m’adores, mais pense à moi de temps en temps… » Cette ritournelle empruntée à Joséphine Baker jalonne le Music-hall de Jean-Luc Lagarce. Sensuelle, amoureuse, rieuse, elle se fait pourtant grinçante, inquiétante au bout de quelques réitérations. Le texte avance, portée par la mise en scène et l’interprétation sans faille de Sophie Planté, vers une mélancolie assumée, jusqu’à se muer en rictus cauchemardesque. Qui est cette femme au caractère bien trempé, qui chante avec force minauderie et danse le flamenco à la perfection ? La formation de danseuse de la comédienne est un atout de taille : les heures de gloire de la star, talonnée par ses boys – formidables Vincent Lagahe, Yohan Leriche et Charles Leys – sont suggérées sans effort avec paillettes. La déchéance est, quant à elle, convoquée par la mise en scène elle-même : la fatigue des corps, le maquillage de plus en plus criard figurent le passage du temps et le spectre de la mort. Ce qui n’empêche pas ce Music-hall de se parer d’un humour certain, inédit dans ce traitement pourtant très naturel de la langue de Lagarce.
Music-hall a été joué du 7 au 30 juillet au théâtre Pierre de Lune, à Avignon.
Quand je serai un homme
Faire genre. Après s’être attelée à dire le féminin, ses contraintes et ses luttes, avec Quand je serai grande…, également donné aux 3 soleils les jours impairs, l’autrice et comédienne Catherine Hauseux s’est intéressée, avec son complice Stéphane Daurat, à ce qui fait le viril, ou du moins le masculin – les jours pairs ! Quand je serai un homme s’est lui aussi construit au fil d’une collecte de témoignages, portant sur la construction de l’identité et de l’altérité. Quelque chose semble cependant s’être perdu en chemin : cette parole-là s’est-elle révélée plus retorse, moins uniforme que son pendant féminin ? Ou, le soupçonne-t-on, moins sincère ? Trop construite ? Trop prémâchée ? Force est pourtant de constater que les moments les plus marquants de la pièce sont ceux qui évoquent, en creux, la perception des femmes, et les rapports que les sondés entretiennent avec elles. Ce qui n’enlève rien aux talents des deux interprètes, ni à l’interprétation en général.
Quand je serai un homme a été joué du 6 au 30 juillet au théâtre Les 3 soleils, à Avignon.
Une opérette à Ravensbrück

À juste distance. Créé en 2019, le spectacle pensé et interprété par Claudine Van Beneden partait d’un pari fou, pour ne pas dire casse-gueule : adapter Le Verfügbar aux Enfers, opérette conçue par Germaine Tillion lors de sa captivité au camp de femmes de Ravensbrück. Réarrangées par Grégoire Béranger et Jean Adam, les chansons ne perdent rien de leur humour salvateur, ni de leur franc désespoir. Interprétés par les comédiennes aguerries de la Compagnie Nosferatu, théâtralement comme musicalement parlant, les airs se réapproprient des extraits d’opéra, de chanson populaire, de publicité pour raconter les horreurs vécues. Celles-ci passent par les corps et les voix de la douce et solaire Solène Angeloni, de la forte tête Angeline Bouille, de la non moins franche Isabelle Desmero ou de la plus mélancolique Barbara Galtier. Face à elle, à juste distance, Raphaël Fernandez incarne le scientifique présentant les verfügbar, dénomination attribuée aux corps rendus disponibles des femmes mobilisées. Celles-ci s’emparent peu à peu de la parole, persistent à exister. Plus encore que la vie de ses personnages et codétenues, on comprend que Germaine Tillion tenait avant tout à préserver leur joie et leur dignité.
Une opérette à Ravensbrück a été joué du 7 au 30 juillet au Théâtre du Chien qui fume, à Avignon.
Téléphone-moi
De la friture sur la ligne. Difficile de comprendre ce qui, dans cette fresque romanesque auto-proclamée, a pu séduire critique et public avignonnais, venu nombreux au 11 tout au long du festival. Téléphone-moi, joué dans la foulée d’Allosaurus, fut pensé par la compagnie f.o.u.i.c comme une sorte de rêverie vintage. Qui se révèle surtout franchement fétichiste : trois cabines téléphoniques y faisant office de décor, et par là-même de capsules temporelles à bas prix. Téléphone-moi se veut ainsi une exploration d’un XXe siècle réduit à :
I. La seconde guerre mondiale, et donc uniquement à la Résistance.
II. Aux années Mitterrand, et donc à la demi-finale France-Allemagne de 1982.
III. Aux années 1990, et donc – évidemment – à France 98.
Le tout prêterait à sourire si le texte et la mise en scène de Jean-Christophe Dollé et Clotilde Morgiève, également de la distribution et par ailleurs très bons comédiens, ne se prenaient pas si terriblement au sérieux. Nombreuses sont ainsi les incohérences et autres paresses de narration dignes des pires séries Netflix. On apprendra donc, ô surprise, que le père d’untel n’est peut-être pas son « véritable » père ; qu’un vivant n’est peut-être plus tout à fait vivant ; que dans toute résistante qui se respecte sommeille vraisemblablement une gourde en mal de mâle alpha… Le tout vise à émouvoir, sans pour autant avoir pris le temps d’observer véritablement les époques concernées, ou de construire des personnages à part entière. Comme si les facilités d’identification, aux costumes, aux chansons d’époque – et non, nous n’échapperons pas à Nicole Croisille – suffisaient à séduire un public en mal d’idoles et, surtout, de mélo.
Téléphone-moi a été joué du 7 au 29 juillet au 11·Avignon.
Et Dieu créa le swing

Lady Traviata. L’intrigue d’Et Dieu créa le swing semble née d’un pari innocent, voire d’une plaisanterie. Soit raconter l’histoire du monde, des femmes, du féminisme, de l’opéra et du jazz, dans un joyeux désordre, et sans jamais recourir à un autre texte que celui de chansons existantes. Avec pour exception le pastiche et les jeux de mots les plus tarabiscotés – mention spéciale à la pauvre Aziza de Balavoine devenue, en plein medley italo-variété, une ode à la pizza. Conçu et mis en scène par Alain Sachs, le spectacle maintient le public hilare une bonne heure et demi. Le mérite en revient aux arrangements et réécritures tous terrains d’Annabelle Sodi-Thibault, mais également à l’énergie carnassière de ses interprètes. Alice Buro, Morgane Touzalin-Macabiau et Ita Graffin enchaînent les tenues improbables et les vocalises éblouissantes. Elles naviguent de la variété au rap, en passant par l’opéra. Jusqu’à mélanger La Traviata aux improbables onomatopées de Lady Gaga ! Au piano, Jonathan Soucasse se révèle d’une solidité à tout épreuve, fort d’un humour et d’une présence qui se marient à merveille avec celui des chanteuses. Le temps d’un très beau Amsterdam ou d’un détour par le Je suis de celles de Bénabar – entre autres – le trio n’oublie pas non plus de darder ses fous rires de quelques sanglots. Une réussite totale.
Et Dieu créa le swing a été joué au théâtre Les 3 Soleils, à Avignon.
Le Temps des trompettes
Molière malgré lui. Une heure et vingt minutes pour aborder la vie de Molière de 1622 à 1658. L’impossible promesse de Félicien Chauveau et de son coauteur Claude Boué n’est heureusement qu’un prétexte. Car Le Temps des trompettes, loin du commentaire composé sur-documenté, n’est rien de moins qu’une vibrante déclaration d’amour, punk et déjantée, au genre mal-aimé de la comédie. L’acteur-metteur en scène s’est déjà frotté à l’œuvre du plus célèbre dramaturge français – son Bourgeois Gentilhomme a remporté un franc succès à Nice et Antibes au printemps dernier. Il s’est, pour raconter les balbutiements et premiers vrais succès d’un auteur somme toute insaisissable, placé au centre d’un dispositif intimiste. Seul en scène, le comédien à l’abattage redoutable incarne une galerie de personnages bien peu académiques. Le langage se fait tantôt châtié, tantôt franchement grossier, sans jamais tomber dans la vulgarité. Jusqu’à explorer une tonalité queer réjouissante, peu exploitée auparavant et plus que pertinente.
Le Temps des trompettes a été joué du 7 au 30 juillet au théâtre du Chêne Noir, à Avignon.
L’Art délicat du quatuor

À quatre épingles. Monté et rodé au fil du festival par Jos Houben, le dernier opus du Quatuor Leonis célèbre les atouts « naturels » de ses interprètes. Pensé comme une conférence sur la formation musicale par excellence, ou du moins comme une préparation à celle-ci, L’Art délicat du quatuor relève du pur plaisir du geste musical, poussé ici sans effort à faire théâtre. Le tout fonctionne grâce au talent des musiciens mais aussi de l’indescriptible alchimie qui s’est créée entre eux. L’altiste est ici l’intellectuel franchement pontifiant du groupe : Alphonse Dervieux gratifie ainsi ses camarades d’anecdotes interminables, auxquelles le violoncelliste Julien Decoin oppose une vision simpliste de la musique, aussi évidente mais aussi prosaïque que la nourriture qu’il évoque et ingère à la moindre occasion. Les violonistes Guillaume Antonini et Sébastien Richaud se disputent la place de chef à la moindre occasion. Si les textes mériteraient quelques ajustements, on se damnerait pour quelques minutes de plus en compagnie de leur Schubert ou de leur Beethoven !
L’Art délicat du quatuor a été joué du 7 au 30 juillet au théâtre du Rempart, à Avignon.
SUZANNE CANESSA
Spectacles présentés pendant le Off d’Avignon 2022
Lire aussi : Vagabondage au fil du Off – Journal Zebuline