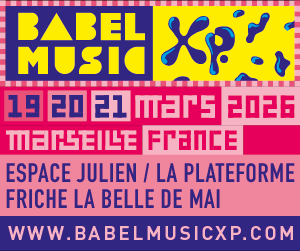Chien Blanc est un livre dérangeant. Parce qu’il bouscule la bien-pensance, soulève des problèmes moraux sans y apporter de réponses, pose un regard lucide sur les motivations profondes de l’engagement et s’interroge sur les modalités de l’action politique. Ecrit en 1970, largement autobiographique, le roman de Romain Gary s’ancre dans l’actualité américaine de la guerre du Vietnam, du rêve assassiné de Martin Luther King, du mouvement des Black Panthers, des émeutes anti-raciales, de leur répression, et des événements de 1968 en Europe. Mais il nous plonge également dans des dilemmes on ne peut plus contemporains. Non seulement parce que le racisme tue toujours aux États-Unis (et ailleurs). Mais encore, parce que nous sommes nombreux à vivre la déchirure décrite par le romancier. Tout cela justifie en soi l’adaptation de ce texte à l’écran proposé par la réalisatrice québécoise Anaïs Barbeau-Lavalette et sa coscénariste Valérie Beaugrand Champagne. Même s’il ne réussit pas tout à fait à traduire l’humour acide de Gary et son style « mordant », ce long-métrage reste fidèle à la trame et à l’esprit de l’œuvre.
1968 : Romain Gary (incarné par Denis Ménochet) a 54 ans. Ex-résistant, Compagnon de la libération, aviateur et héros de guerre multi médaillé, gaulliste, humaniste, universaliste, diplomate, le célèbre écrivain vit entre les USA et l’Europe, avec Jean Seberg (Kacey Rohl) de 24 ans sa cadette, et leur fils Diego âgé de 6 ans (Bruno Lemaire). Jean est au sommet de sa gloire d’actrice. Elle milite au sein de la NAACP (Association Nationale pour la Promotion des Gens de Couleur). Leur belle maison de Beverley Hill est pleine d’activistes. Jean leur fait des chèques. Romain, quoique révolté par l’oppression des Afro-Américains se moque d’elle et des « belles âmes » d’Hollywood, qui ne cherchent pas à soulager les Noirs mais leurs mauvaises consciences de Blancs, s’appropriant une lutte qui n’est pas la leur.
Un film à strates
Le film commence avec l’assassinat de Martin Luther King, le discours de Robert Kennedy et, sous une pluie battante, l’arrivée, au foyer des Gary-Seberg, d’un berger allemand sans collier. La bête affectueuse s’avère être un « chien blanc », c’est à dire un animal dressé à chasser tout individu de peau noire utilisé par les propriétaires sudistes. S’opposant à sa femme, Romain refuse de l’euthanasier et le confie à un dresseur afro-américain Keys (K. C. Collins) pour le « déprogrammer ». L’enjeu sera de prouver qu’on peut faire marche arrière, guérir du racisme inculqué, et « croire encore aux hommes parce qu’il importe moins d’être déçu, trahi par eux que de continuer à leur faire confiance ».
Le film va suivre plusieurs pistes : on suit notamment l’évolution du contre-dressage du chien, le délitement du couple Jean/Romain, les efforts candides de Seberg qui se retournent contre elle et parfois contre ceux pour lesquels elle se bat, la plongée dans l’univers des activistes… Les images d’archives télévisées ponctuent l’autobiographie romancée ; la fable allégorique accompagne le documentaire, s’émaille de phrases-citations qu’on voudrait toutes retenir. Réflexions sur ce que signifie être américain, être humain, être écrivain. Dans les interviews qui initient et concluent le film, Romain Gary affirme qu’on n’écrit pas pour dénoncer une horreur mais pour s’en débarrasser. Le lecteur non plus que le spectateur ne se débarrasseront pas aussi aisément ni du livre, ni du film qui donne les derniers mots à Christiane Taubira ; ceux de son beau poème Seuls et Vaincus mis en musique par Gaël Faye et Mélissa Laveaux.
ÉLISE PADOVANI
Chien blanc,d’Anaïs Barbeau-Lavalette
En salles le 22 mai
© Sphère