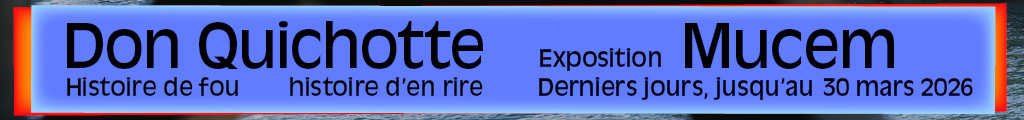C’est un nouveau rendez-vous, qui va ponctuer l’année 2025 puis 2026 à Marseille. Un festival d’histoire publique porté par la Ville de Marseille, en partenariat avec la revue L’Histoire, La Provence et Aix Marseille Université (Amu), qui entend « faire de l’histoire un bien commun vivant, partagé et accessible à toutes et tous. » Ce 4 juillet au Musée d’histoire, La Folle Histoire de Marseille accueillait les deux premiers rendez-vous de cette première édition « expérimentale » : une exposition sur les escaliers de la gare Saint-Charles, témoins du passé colonial de la ville, et une table ronde qui s’interrogeait sur le cosmopolitisme de Marseille.
2025, exposition décoloniale
Au sous-sol, le musée présente l’exposition Les statues des escaliers de la gare Saint-Charles. Comment le passé colonial de Marseille marque le paysage urbain. Un premier rendez-vous pour La Folle Histoire de Marseille conçu par Samia Chabani – sociologue, directrice de l’association Ancrages, et collaboratrice au journal Zébuline rubrique Diasporik– qui met en avant l’histoire impériale et coloniale de la ville. Elle adopte une approche critique, invitant à débattre de l’iconographie coloniale encore présente dans l’espace public, en particulier dans cet escalier monumental.
Des panneaux et illustrations analysent les représentations symboliques présentes sur ces escaliers. Ils reflètent une conception hiérarchique de la société, marque de l’époque coloniale : au plus haut, les lions d’Ary Bitter, qui personnifient « Marseille et le Commerce/Marseille et l’Industrie ». Un palier en dessous, les pylônes d’Auguste Carli, avec Marseille en colonie grecque et porte de l’Orient. Et plus bas, des figures de femmes et d’enfants d’Afrique et d’Asie, : allégories coloniales de 1924 réalisées par Louis Botinelly sur les consignes précises du Port et des édiles. Des représentations qui sexualisent, voire animalisent, les femmes racisées représentées. L’exposition présente aussi les maquettes d’origine de ces statues, une affiche de l’exposition coloniale de 1922, ainsi que des mini-documentaires de Mars Imperium à découvrir.
Une histoire en mouvement
S’en est suivi une table ronde intitulée « Marseille : Porte du monde ? », vouée à éclaircir les récits migratoires à l’aide de quatre historiens spécialisés de l’Antiquité à l’époque actuelle. Modérée par Valérie Hannin, directrice de la rédaction de la revue L’Histoire et co-initiatrice du festival, la discussion interroge les imaginaires de Marseille « ville cosmopolite ». Si le point d’interrogation de la dénomination de la table ronde peut surprendre, Céline Regnard, historienne spécialiste des migrations et de Marseille à l’époque contemporaine, précise qu’en 2021, 15,7 % des habitants de Marseille sont nés à l’étranger, contre 20 % en région parisienne.
L’échange se poursuit à l’époque de la Grèce antique avec Paulin Ismard, historien politique et social de cette période ; passe par Gilbert Buti, historien spécialiste d’histoire économique et sociale de l’Europe méditerranéenne moderne, qui analyse une peinture diffusée incarnant la diversité des peuples présents le vieux port de Marseille ; poursuit avec Benjamin Stora, grand historien spécialiste de l’Algérie contemporaine, qui évoque la connexion entre Alger et Marseille ainsi que les récits oubliés de cette communauté ; et revient à Céline Regnard, qui s’attèle à défaire les stéréotypes et à remémorer l’ambivalence de la ville.
LILLI BERTON FOUCHET
Retrouvez nos articles Politique Culturelle ici