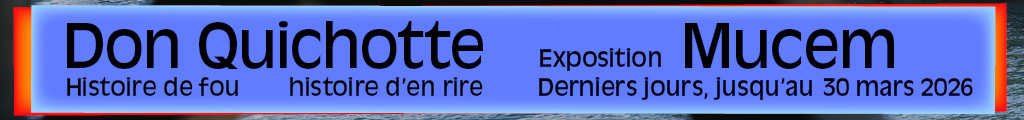À l’hôtel de Caumont, à Aix, l’exposition Bestiaire magique de Niki de Saint Phalle ne mentionne nulle part l’inceste qu’elle a subi lorsqu’elle avait 11 ans. Un viol qu’elle a révélé en 1994, dans Mon Secret, qu’elle a écrit à la main et illustré. L’artiste des Nanas joyeuses, des fontaines animées et des bestiaires fantastiques y explique que son œuvre est une tentative de réappropriation de son enfance, de son corps et de sa puissance. Écrit comme une lettre à sa fille, le livre a modifié profondément la perception que l’on avait de son œuvre. Comment peut-on aujourd’hui lui consacrer une exposition sans en faire, pour le moins, mention ?
Car la pionnière du Nouveau Réalisme, est surtout précurseure d’un art féministe. « Le temps est venu d’une nouvelle société matriarcale » écrivait-elle dans les années 1970. Cinquante ans après, et après #Metoo, laisserons-nous l’histoire revenir désespérément en arrière ?
Nous sommes visiblEs
Précurseure. Le mot, puisqu’il désigne celui qui ouvre le chemin, n’a pas de féminin en français académique, comme chef, professeur, médecin, recteur, colonel, metteur-en-scène, écrivain, maire. Si des femmes qui exercent ces fonctions les transforment en nom féminin avec quelques articles ou des jeux de suffixes (la maire, la prof, l’écrivaine, la rectrice), l’affaire se corse dès que la féminité se fond dans un groupe mixte : les femmes, alors, disparaissent, même quand elles sont majoritaires, puisque « le masculin l’emporte sur le féminin ». Règle si profondément discriminatoire qu’on oublie qu’elle n’est pas immuable : jusqu’au XVIIIe siècle, en français, le plus grand nombre prévalait (Roxane, Hector et Hermione sont tombées des nues) et en cas d’égalité la règle de proximité s’appliquait (Valère et Elvire sont amoureuses).
L’effacement graphique de la composante féminine d’un groupe mixte s’accompagne en français de l’absence caractéristique de certaines désignations qui permettent aux hommes une complexité sociale. Ainsi les garçons sont les fils de leurs parents, et les filles juste des filles. Et les hommes peuvent être des maris, alors que les femmes demeurent simplement des femmes. Elles sont ainsi naturellement réduites à leur fonction familiale, comme elles sont exclues des Droits de l’Homme et de la Fraternité.
Nous sommes inclus·e·s
L’écriture inclusive est un des moyens de rattraper aujourd’hui ces faiblesses de notre langue nationale et de laisser une trace écrite de la présence des femmes dans des métiers, des fonctions, des réalités qui les excluaient, et continuent souvent à les exclure.
Mais il est devenu dangereux d’ajouter des points médians, de féminiser les noms, de revenir à d’autres règles orthographiques, ou de pratiquer le néologisme comme l’ont toujours fait toutes les langues vivantes et productives. Et plus impensable encore de naviguer entre les genres, de pratiquer le iel ou d’écrire « il est belle ».
Que Trump interdise le féminisme et les études de genre n’est pas étonnant, il a été élu après une violente campagne masculiniste. Que Zemmour s’en gausse, qu’importe. Mais que la Région Sud prescrive l’écriture inclusive dans les demandes de subventions et coupe à ce titre sa subvention à Kourtrajmé est pour le moins inattendu… Comment peut-on dans la même charte défendre la liberté de création et interdire l’écriture inclusive ?
L’offensive réactionnaire contre les avancées de la langue a toute la violence des invisibilisations. Les femmes qu’on enferme, qu’on voile ou qu’on empêche de se voiler, celles qu’on sexualise à leur insu ou qui se garnissent, de leur plein gré, d’appendices ongulaires ou capillaires, peinent toujours à s’approprier leur image qui reste dessinée, décidée, écrite sans elles. Le masculin l’emporte : au-delà de l’écriture, la grammaire et la langue modèlent nos représentations.
Faisons parler les images
Gisèle Pélicot, en rendant public le procès de ses violeurs, a fait changer la honte de camp.
La fille du premier ministre, en témoignant pour que les victimes de Bétharram soient entendu·e·s , permettra sans doute d’ouvrir les portes trop closes des pensionnats catholiques.
Mare Nostum puis SOS Méditerranée sont nés après l’image choc du naufrage au large de Lampedusa en 2013.
Filmé, diffusé. Puis oublié, faute de relais médiatique.
À Gaza, les journalistes et les images sont interdites.
La visibilité est un combat. Jusque dans l’écriture.
AGNÈS FRESCHEL
Retrouvez nos articles Société ici