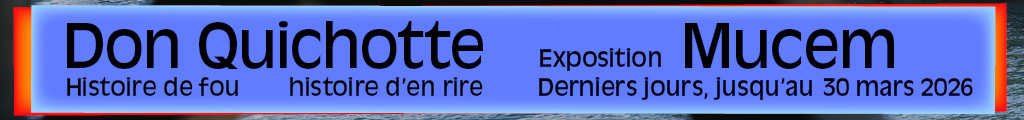Son travail sur la traduction, le dialogue interculturel et la philosophie islamique, est reconnu comme une réflexion fondamentale sur l’universalisme et la pensée plurielle entre Afrique et Occident. Ses dernières publications s’intitulent d’ailleurs Universaliser (2024) et Les universels du Louvre, paru en novembre 2025
Diasporik. Les Nouvelles Rencontres d’Averroès vous invitent à un grand entretien sur le thème « Prendre langue, se parler ». Cette thématique se décline dans une programmation articulée autour de trois verbes : converser, négocier, traduire. Dans quel ordre pensez-vous les aborder ?
Souleymane Bachir Diagne : Je commencerai par « traduire ». J’y ai consacré un ouvrage intitulé « De langue à langue. L’hospitalité de la traduction », publié en 2022 chez Albin Michel. La traduction nous offre l’opportunité d’accueillir l’identité de l’Autre en la nôtre, d’ouvrir notre propre identité à celle d’autrui. C’est pourquoi je débute par ce verbe, qui est déjà la possibilité d’une ouverture…
L’expression « de langue à langue » désigne ce processus philosophique par lequel la pensée s’inscrit comme un mouvement constant de traduction et de dialogue entre diverses langues et cultures. Un processus qui permet le décentrement et l’accueil de l’Autre, en somme, en cultivant la capacité de voir le monde depuis plusieurs perspectives linguistiques et culturelles, et instaurant ainsi une posture de traduction perpétuelle.
Ensuite, je mettrai « négocier », parce que cette ouverture facilite la négociation, c’est-à-dire le moment d’échange d’idées qui fonde la proximité nécessaire à la conversation, que je placerai en troisième position. Une fois la traduction effectuée et la négociation amorcée, la conversation peut alors s’installer pleinement. Il m’a semblé essentiel de mettre en lumière le rôle central de la traduction, quand bien même nos langues portent la marque de nos différences ; ces différences ne doivent pas être perçues comme des « incommensurabilités »…
L’arabe est ainsi une langue d’ouverture à l’universalisation de la pensée philosophique
Dans vos publications, vous décrivez la ligne de crête complexe entre la décolonisation des savoirs et la réinvention d’un universalisme cosmopolitique. Comment tendre vers cet objectif dans un monde si fragmenté ?
Nous restons face à deux défis, poursuivre la décolonisation amorcée d’un universalisme impérial et surplombant et celui d’une réinvention en cours, inclusive de toute l’humanité. Tel que le disait Alioune Diop fondateur de la revue Présence Africaine, en 1947 « Désoccidentaliser pour universaliser tel est notre souhait. Pour universaliser il importe que tous soient présents dans l’œuvre créatrice de l’humanité ».

Par ailleurs, nous traversons une époque paradoxale, où tous les moyens technologiques de rapprochement semblent à notre portée, incarnant une certaine « conscience horizontale globale », à l’instar de ce que nomme le philosophe Francis Wolff. Pourtant, loin de favoriser l’échange, ces outils s’accompagnent d’une intensification des polarisations.
Les discours politiques, en Europe comme ailleurs, s’organisent autour de la stigmatisation de l’Autre. La question migratoire nourrit l’essentiel de la rhétorique de certains partis d’extrême droite ou suprémacistes, reléguant les populations migrantes à une forme d’inhumanité.
Par exemple, aux États-Unis, les archevêques viennent de dénoncer les pratiques d’arrestation et d’expulsion, dans un article du New-York Times, et appellent à un retour au respect de la dignité humaine. Au Sénégal, les appels se multiplient pour un apaisement des débats politiques, tout comme lors des campagnes électorales, qui, à l’image des récentes élections en Tanzanie, ont connu de nombreuses dérives. Les discours politiques qui sont remplis de haine mettent en danger les sociétés et neutralisent la capacité à partager des débats sereins.
L’universalisme cosmopolitique devrait découler naturellement des défis majeurs auxquels l’humanité est confrontée : le réchauffement climatique, les crises sanitaires telles que la pandémie de Covid, qui imposent une action collective à l’échelle mondiale.
Pourquoi les traditions juives et arabes sont-elles toujours perçues comme moins imprégnées par l’humanisme universaliste, aujourd’hui ?
C’est là une question de perception. La religion musulmane est parfois vue comme un particularisme, alors qu’elle est, tout au contraire, une ouverture vers l’universel. Elle s’adresse à l’humanité en tant qu’humanité. Je n’ai de cesse de rappeler que l’islam est une civilisation de la traduction, comme en témoigne Bayt al-Ḥikma, la « Maison de la Sagesse » évoquée dans les sources arabes médiévales. Ce centre intellectuel fondé à Bagdad sous le règne du calife al-Maʾmūn (813-833) a vu l’émergence de multiples bibliothèques et cercles de traducteurs, qui ont rendu possibles de nombreuses traductions des textes grecs vers le syriaque puis l’arabe, notamment dans les arts et les sciences. Cet héritage illustre combien la langue arabe fut celle de la philosophie, un aspect trop souvent méconnu, y compris chez les musulmans.
L’arabe est ainsi une langue d’ouverture à l’universalisation de la pensée philosophique. L’islam, au même titre que le christianisme, est une religion universelle : elle s’adresse à l’humanité et non à un peuple particulier. Enfin, il faut souligner qu’Averroès, Maïmonide et Avicenne, trois figures essentielles de la philosophie médiévale, incarnent cette articulation décisive entre pensée rationnelle et traditions. Tous trois issus du monde arabo-musulman et juif, ils ont puisé dans les textes antiques en cherchant à concilier foi et raison.
Il est important de rappeler combien le monde islamique s’est ouvert à la philosophie, et il faut saluer que Les Nouvelles Rencontres d’Averroès participent activement à créer des espaces où cette dimension universelle et d’ouverture peut s’exprimer pleinement.
Samia Chabani
Grand entretien
Les langues de Souleymane Bachir Diagne
le 22 novembre à 18h
La Criée
Entrée libre, réservation conseillée
Retrouvez nos articles Société ici
Nos articles Diasporik, conçus en collaboration avec l’association Ancrages sont également disponible en intégralité sur leur site