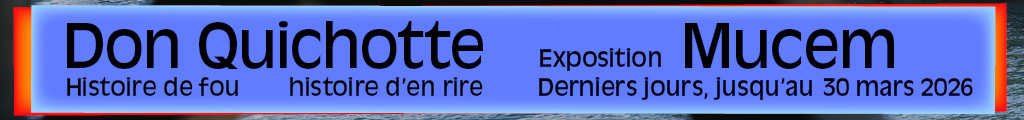Diasporik. Yennayer, le nouvel an amazigh, se célèbre du 12 au 14 janvier selon les régions. Pourriez-vous expliquer les origines de cette célébration ?
Malika Assam. Yennayer est à la fois un ensemble de rituels et un moment qui s’inscrit dans une certaine perception du temps. Dans l’antiquité, c’était le point de départ de l’année agricole solaire et, avec la romanisation, ce jour s’est confondu avec le 1er jour du calendrier julien. Il célèbre probablement le renouveau des jours à compter de l’allongement de la durée diurne mais aussi un passage par Tiwwura useggas « les Portes de l’année » : on termine les récoltes de l’année et il faut attendre celles à venir pour survivre. La nuit du nouvel an est vécue comme un moment de basculement. De nombreux rites familiaux visent notamment à écarter la famine. D’où un repas aussi copieux que possible la veille de Yennayer : Imensi n Yennayer ou Id Yennayer.
Quelles ont été ses évolutions et quel est son sens aujourd’hui ?
Dans des sociétés de moins en moins agricoles, Yennayer s’est adapté sous l’influence du militantisme berbère/amazigh. Rappelons que jusqu’à la fin du XXe siècle les États du Maghreb se définissaient tous exclusivement comme arabes et musulmans. Contre cette définition, dès les années 1970, l’association L’Académie berbère a formalisé une ère amazighe en faisant coïncider cette célébration avec un événement historique : l’intronisation du pharaon Sheshonq Ier en -950, un pharaon qui serait issu de l’installation ancienne de Libyens orientaux en Égypte, et n’a pas tardé à devenir dans le discours militant un pharaon « amazigh ».

De fait, Yennayer s’est diffusé hors du cadre familial et a servi à revendiquer la dimension amazighe des populations. La célébration est devenue plus collective et a investi les espaces publics diversement, des fêtes villageoises en Kabylie à la célébration dans diverses mairies en émigration, pour revendiquer une place dans la cité… Avec la reconnaissance de l’amazighité en Algérie et au Maroc, ce jour s’est institutionnalisé comme jour férié et permet de mettre la culture amazighe à l’honneur (concerts, conférences, expositions d’objets artisanaux ou ateliers de pratiques diverses…), au risque qu’elle soit commercialisée et folklorisée. Il y a finalement aujourd’hui autant de Yennayers que d’enjeux sociaux ou politiques !
Les langues et cultures amazighes ont survécu à l’émergence de l’écrit, aux conquêtes arabes puis coloniales, ottomane et française. Comment les résistances se sont-elles opérées ?
Les sociétés amazighes ne sont pas des sociétés orales, mais à dominante orale. Elles ont depuis longtemps connu la pratique de l’écrit, y compris avec un alphabet propre qui a laissé de nombreuses inscriptions libyques : l’inscription dite « bilingue de Massinissa » date du IIe siècle avant notre ère. Le libyque a ensuite donné les tifinaghs que les Imajaghen [les Touaregs, ndlr] ont continué à utiliser jusqu’à aujourd’hui. Même lorsque la conquête arabo-musulmane islamise la région et diffuse, très progressivement, la langue arabe, on voit apparaître la pratique de l’écrit en langue berbère avec les caractères arabes, qui va perdurer dans certaines régions, comme le Souss au Maroc, jusqu’au XXe s.
Mais il est vrai que le canal privilégié pour la transmission de la mémoire collective et de la littérature a été l’oralité. Dans des espaces où le mode de gouvernement n’était pas celui d’États centralisés, la cohabitation de plusieurs langues n’était pas problématique. Elle l’est devenue lorsque la colonisation et les courants nationalistes qui lui répondent imposent le modèle de l’État-Nation qui pose une équation : une nation = une langue = un État.
Quelle a été l’origine du déclenchement du printemps berbère en 1980 en Algérie?
Cette équation explique qu’à l’indépendance, la berbérité a été perçue comme une menace à l’unité nationale et occultée progressivement. Les gouvernements craignaient qu’elle n’appuie des revendications politiques. En parallèle, ils lancent les politiques dites d’« arabisation », vécues comme répressives notamment en Kabylie où l’affirmation identitaire berbère est précoce et profondément ancrée dans toutes les couches de la population. Les jeunes étudiants qui peuvent à partir de la fin des années 1970 faire leurs études à Tizi-Ouzou sont particulièrement actifs. En 1980, une conférence qu’ils avaient organisée autour de Poèmes kabyles anciens, ouvrage de l’écrivain et anthropologue spécialistes des Berbères Mouloud Mammeri, est interdite officieusement par les autorités, et c’est toute la région qui s’embrase pour défendre les « langues et cultures populaires » face à une répression violente.
Quelles en ont été les conséquences, jusqu’à aujourd’hui?
Ce premier événement a secoué le monolithisme de la vie politique algérienne ; il a eu aussi des répercussions à l’échelle locale où désormais, l’affirmation berbère/amazighe en Kabylie se fait au grand jour. Plus largement, au Maghreb, cet exemple de mobilisation a renforcé les mouvements d’affirmation identitaire qui ont fini par tisser de nombreux liens. Selon les régions et les États, les actions ont été plus ou moins réprimées mais « la langue et la culture amazighes» ont fini par être institutionnalisés en Algérie et au Maroc.
Dans vos enseignements à l’université d’Aix-Marseille, quelles sont les disciplines mobilisées, en langue, en histoire… ?
À l’Amu, les étudiants de diverses filières, notamment de la licence d’arabe mais aussi des diverses spécialités en sciences humaines et sociales, peuvent s’initier à la langue berbère, avec cette année deux langues possibles en initiation, le rifain et le kabyle. Ils peuvent continuer cet apprentissage pendant 3 ans. Par ailleurs, il y a deux cours sur l’histoire, ancienne et contemporaine, des mondes berbères et deux cours pour s’initier à la linguistique et aux enjeux sociolinguistiques. Enfin, le parcours Moyen Orient-Maghreb du master Langues et sociétés initie aux enjeux des études berbères/amazighes aujourd’hui. Et il est possible de se spécialiser en études berbères grâce à un diplôme en partenariat international qui prévoit un semestre en mobilité à l’université de Naples l’Orientale.
Quels sont les profils de vos étudiants, aujourd’hui ?
Les étudiants sont en majorité issus des migrations maghrébines en France, de familles berbérophones et aussi aujourd’hui d’arabophones qui s’intéressent à cette autre langue du Maghreb. Mais il y a aussi quelques étudiants qui n’ont pas de lien particulier avec le Maghreb et qui au regard de leurs projets d’étude, souhaitent s’initier à cette langue et aux dynamiques amazighes.
ENTRETIEN RÉALISÉ PAR SAMIA CHABANI
Yennayer, nouvel an berbère
1er février, Conférence à17h30 suivie d’un concert à 19 h de Nouredine Chenoud
Maison des associations, Marseille
À l’initiative de l’association Coup de soleil
Retrouvez nos articles Société ici
Nos articles Diasporik, conçus en collaboration avec l’association Ancrages sont également disponible en intégralité sur leur site