Entre votre court métrage L’homme le plus fort en 2014 et L’Engloutie votre premier long métrage sélectionné à Cannes en 2025, 10 ans se sont écoulés. Récemment une réalisatrice nous confiait : « Il me faut trouver une histoire qui m’importe autant pour faire un deuxième film. Sinon ça ne vaut pas le coup » Est-ce la même chose pour vous ?
Quand on écrit un film, on sait qu’on va passer deux, trois, quatre, voire cinq ans dessus. Entre le moment où on écrit les premiers mots et celui où il sort au cinéma. Il peut même s’en passer davantage : moi, L’Engloutie, j’ai commencé à l’écrire en 2019. Il faut que ce soit quelque chose qui nous tienne à cœur et dont on ne se lasse pas. Forcément, comme c’est long et plein d’embûches, parfois on en a marre. On est quelquefois écœuré de son propre projet. Il faut retravailler, réécrire, en reparler sans cesse pour réussir à convaincre. Mais une fois que les financements sont là, toute l’envie revient et c’est parti !
Comment avez-vous construit le personnage d’Aimée, que vous n’avez pas voulu, semble-t-il, rendre absolument sympathique…On est de son point de vue de sorte qu’on ne sait pas toit d’elle : ses rapports avec ses parents, son origine, ses motivations…
En effet, ça me plaisait de créer un personnage féminin qui ne soit pas la jeune première héroïque et gentille. J’aimais que cette jeune femme puisse se tromper, être de mauvaise foi. Elle arrive pleine de bons sentiments à vouloir déployer sa mission républicaine, apporter l’égalité et le savoir pour tous. Mais aussi, en pensant qu’elle arrive au pays de l’ignorance, qu’elle va éduquer des populations. Il y a quelque chose de présomptueux de sa part. D’autant, qu’elle n’a aucune expérience et qu’elle va se frotter au Réel. Donc ça me plaisait d’avoir un personnage avec plein de défauts. Pour autant, il fallait trouver une actrice qui en fasse quelqu’un d’attachant, une femme avec laquelle on peut entrer en empathie et dont on peut partager toutes les émotions en restant de son point de vue.
Son nom est Aimée Lazar : Aimée parce que malaimée au départ ? Lazar pour une résurrection ?
Aimée, bien sûr, parce qu’il y a un rapport avec l’amour. Le spectateur ne sait pas comment elle s’appelle jusqu’à très tard dans le film : c’était pour que ce moment de révélation soit tendre et émouvant. Et Lazar, en effet, c’est un clin d’œil au mythe de Lazare. En fait, au départ, j’aimais beaucoup le film d’Alice Rohrwacher, Heureux comme Lazzaro. Quand on cherchait un nom, j’ai pensé à Lazare. Faut toujours savoir pourquoi on choisit un nom. Et c’est la première fois que quelqu’un le remarque.
Le titre L’engloutie s’est-il imposé dès le début ? L’Engloutie, c’est Aimée Lazar ?
Oui, l’Engloutie, c’est au féminin : c’est elle. Mais c’est comme un titre de conte, de légende. J’ai voulu que ce titre apporte une tension. On regarde le film, et tout le long, on se dit : « mais quand est-ce que ça va arriver ? » On est en montagne, on pense aux avalanches …. C’était donc d’abord une idée dramaturgique. Après il y a tout un jeu symbolique : qui engloutit qui ? C’est un monde qui veut en avaler un autre avec la destruction des patois, l’effacement des régionalismes. Mais aussi, la lutte contre l’obscurantisme. Qui mange qui ? Et puis, bien sûr, il y a le rapport à la sexualité, à l’engloutissement du désir. On a ainsi plein d’échos et de strates possibles pour interpréter ce titre.
Pourquoi avoir choisi une époque charnière : la fin du XIXème siècle, la naissance du XXème ?
La création d’écoles publiques dans les villages les plus reculés de France- au début, dans des étables avec un équipement sommaire, c’est plutôt vers 1882. Mais pour mon scénario, symboliquement, j’aimais qu’il y ait ce passage au nouveau siècle, qu’il y ait une bascule temporelle vers le monde nouveau qui soit comme un vertige. Comme les choses ne se sont pas faites en un an, c’était historiquement crédible.
Pourquoi cette référence récurrente à L’Algérie ?
L’idée c’est que ça fait partie de l’histoire des Alpes. Il y a des villages entiers qui se sont vidés. On a donné à ces gens des terres en Algérie parce qu’ils savaient cultiver des sols arides. J’avais beaucoup d’images de la guerre d’Indépendance, du retour des Pieds-noirs mais je ne m’étais jamais posé la question de qui était parti, quand… Le mélange entre ce que je connais des Hautes Alpes, de la neige en hiver et de l’histoire de la colonisation de l’Afrique du Nord, ça a créé un contraste qui m’a saisie. Cet ailleurs implique un hors champ au film. Pour les Alpes, c’était l’Algérie, c’était la Californie. Plus au sud c’était le Mexique avec les Barcelonnettes, c’est tout ce 19è siècle-là dont il s’agit. Et c’est, même si ce n’est pas équivalent, il y a un parallèle entre une République qui arrive en conquérante dans les régions et la colonisation. Il s’agit d’effacer la langue, d’imposer ses valeurs et ses mœurs.
Votre film est à la fois un film historico-anthropologique et un film fantastique. Comment avez-vous mêlé ces genres ?
J’ai un rapport très fort au Réel. J’accumule les documents sur l’histoire des Hautes Alpes depuis longtemps. J’ai grappillé des choses que je trouvais intéressantes à mettre en images comme le pain qu’on enflamme. La réalité a souvent plus d’inventions que nous. C’est comme une besace où je vais chercher des éléments pour mon histoire. Pas pour une reconstitution ethno-historique mais pour servir l’ambiance, nourrir le conte. Après l’histoire en elle-même, elle vient davantage de ce qu’on m’a raconté étant enfant, dans la famille de ma mère où il y avait beaucoup d’instituteurs, d’institutrices qui allaient « hiverner » dans ces écoles où personne ne voulait aller. Ces récits titillaient l’imagination, étaient porteurs de peurs : une fille seule dans des régions hostiles, le danger des avalanches, les légendes inquiétantes… Mon grand-père avait écrit une nouvelle pour nous avec un vieux villageois qui meurt et dont on met le cercueil sur le toit de l’école en attendant que la terre soit meuble. Des trucs terrorisants qu’on adore quand on est petit et qui flirtent forcément avec le fantastique. Dans le film, c’est presque une expérience scientifique : une créature cartésienne qu’on plonge dans un bain de mysticisme, de superstitions. Jusqu’où son esprit rationnel va-t-il résister ? A quel moment l’irrationnel qui émane aussi d’elle, de son rapport à la sexualité et au mystère, va-t-il la pousser dans ses retranchements jusqu’à ce qu’affleure la figure de la sorcière ? Le film joue avec tous ces archétypes-là. Il aborde le mystère. Le fait que la nature a horreur du vide, qu’on ne supporte pas de ne pas savoir. Les religions, les superstitions vont donner un sens, une réponse alors que l’esprit scientifique apporte le doute.
Comment avez-vous travaillé avec votre directrice de la photographie Marine Atlan ? Et pourquoi le choix de ce format en 4/3 ?
Nous sommes allées en repérage avec Marie Atlan et Anna Le Mouël, la cheffe déco ( Lire ICI son interview). La montagne est souvent filmée en plans larges, en panoramiques, parce que c’est majestueux. Moi j’avais envie de ce format en 4/3. Au départ, comme un clin d’œil au cinéma muet des origines, parce que ça se passe dans ces années-là. Et puis c’était juste une intuition de ce que ça allait créer à l’écran. Et en effet, ça a créé de la verticalité, du vertige et aussi une sorte d’angoisse : un effet d’étau avec le côté huis clos en plein air. Pour la lumière, en montagne, on a peu d’accès à l’électricité et ça allait bien avec mon envie de travailler avec la lumière naturelle, de la magnifier. De montrer ce que ça fait, une pleine lune sur le manteau neigeux qui est comme un réflecteur géant. On a l’impression que c’est une nuit américaine alors que c’est un phénomène naturel. Je voulais que tout le côté fantastique du film vienne du réel, qu’on aille chercher ce qui est étrange et faux dans le vrai. Et pour les intérieurs, pareil : les chandelles, ça coûtait cher. Il y avait le point chaud de l’âtre et quelques chandelles : ça a créé, à l’image, du mystère avec les zones sombres. Et ça collait avec la mise en scène et le sujet du film, entre la lumière, le savoir et les ténèbres, l’inexplicable : tout ça semblait faire corps. Ce qui ne veut pas dire qu’il n’y a pas tout un travail de lumière. Au contraire, il est énorme ! Par exemple, on a des bougies de cinéma avec deux mèches pour éclairer davantage et on a dû placer d’autres points de lumière sans qu’on les voie. C’est un travail d’orfèvre !
Pour incarner Aimée, Galatea Bellugi : comment l’avez-vous repérée ? Pourquoi elle ? Comment avez-vous casté et dirigé les villageois ?
Galatea arrive assez tôt dès que j’ai fini mon scénario. Je devais faire des essais pour une résidence de mise en scène qui s’appelle Emergence. Je l’ai appelée parce qu’elle me faisait penser à Catherine Mouchet dans Thérèse d’Alain Cavalier. Elle a cette voix, cet accent qui n’appartient qu’à elle, et elle semblait me projeter dans le passé. Elle est mystérieuse mais en même temps pas du tout opaque. On voit ce qu’elle pense. Et c’était important puisque Aimée ne parle à personne et que le spectateur doit deviner ce qu’elle a dans la tête. Il fallait aussi quelqu’un d’attachant comme elle, qu’on ne puisse s’empêcher d’aimer malgré ses côtés antipathiques. Et pour le jeu, il fallait être dehors dans le froid, réussir à aller d’un point A à un point B sans s’enfoncer, sans glisser, avec une robe lourde, un corset, et tout d’un coup il y a quelque chose de l’engagement du corps immédiat. Je lui ai demandé de travailler sa langue et elle a dû comme les autres acteurs professionnels, Matthieu Lucci, Samuel kircher et Sharif Andoura savoir accueillir dans son jeu, les acteurs non professionnels. Les acteurs ne connaissaient pas la montagne et n’étaient pas dans leur milieu naturel, les non-professionnel ne connaissaient pas le jeu dramatique mais étaient en revanche chez eux. Chacun avait une forte connaissance que l’autre n’avait pas : ça les a mis sur un pied d’égalité. Pour le choix des villageois, la directrice de casting a contacté les clubs de patois. Le dialecte occitan de la Région est encore vivace. Ça semblait plus difficile avec les enfants qui ne le parlent plus mais ils ont une bonne oreille et ont su dire leur texte, et ceux qui venaient des vallées italiennes avaient un accent qui les rendait très crédibles.
Comment avez-vous travaillé avec Emile Sornin, compositeur de la musique du film ?
J’avais déjà travaillé avec lui sur 6 ou 7 projets – cinéma documentaire, théâtre. Lui avait déjà une expérience de longs-métrages de fiction avec De nos frères blessés de Hélier Cisterne ou Simple comme Sylvain de Monia Chokri . L’idée, c’était de ne pas avoir une musique romantique avec violons et drame. Il fallait casser la chronique rurale, apporter d’emblée des indices de fantastique. Il m’a parlé des voix d’Ennio Morricone. Ça évoquait pour moi plein de choses, un chœur d’enfants, un sabbat de sorcières, la voix de la montagne. C’était très polysémique. Et puis, il y a eu la volonté de travailler sur une musique modeste avec des instruments de fortune, ou des instruments folkloriques détournés. Le travail s’est fait en amont et pendant le montage. Je n’arrive pas à monter mon film sans avoir l’ambiance musicale. Émile a donc travaillé à partir du scénario. Il m’a envoyé plein de morceaux pour des scènes qu’on avait définies ensemble puis il a complété.
Un entretien réalisé par Annie Gava et Elise Padovani
Lire ICI la critique du film
Louise Hémon © A.G

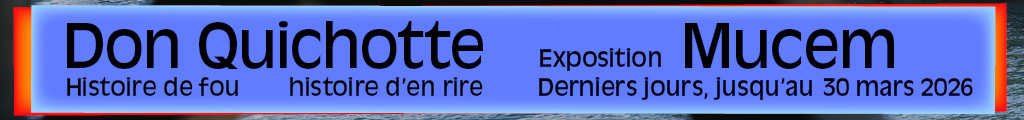



![[ Canebière Film Festival] Avec Anna Le Mouël](https://i0.wp.com/journalzebuline.fr/wp-content/uploads/2025/10/Anna-le-Mouel-2.jpg?resize=324%2C160&ssl=1)