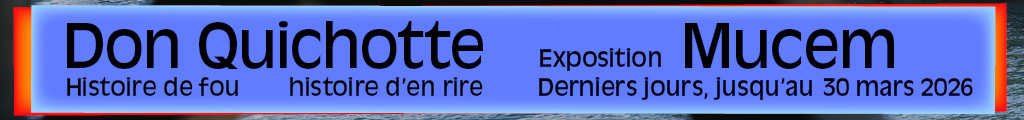Le public est là, le cœur serré, et l’angoisse est palpable dans les salles pleines. Que va t-il nous arriver demain ? La conversation politique est sur toutes les lèvres, et la programmation de cette première semaine y a apporté des réponses décalées, sensibles, pleines d’une humanité faite d’identités multiples et de réponses à l’oppression.
Au Nord de l’Afrique du Sud
À La Criée, Robyn Orlin. La chorégraphe Sud Africaine qui a commencé sa carrière alors que l’Apartheid régnait encore, sait fabriquer des images chocs, des rapports d’humanité queer qui renversent les dominations. Son spectacle How in salt deserts it is possible to blossom (Comment il est possible de fleurir/ s’épanouir dans un désert de sel) ne se pose pas comme une question mais comme une affirmation, forcenée, de la résilience et de la vie. De la guérison possible.
Les « coloured » d’Okiep, ancienne cité minière dont la population, pas assez blanche et pas assez noire, est laissée à sa pauvreté, voit chaque année le désert fleurir après les torrentielles pluies de juillet. La chorégraphe est allée à leur rencontre, et les cinq danseurs du Garage Dance Ensemble et les trois musiciens de uKhoiKhoi font véritablement fleurir la scène. Couverts d’épaisseurs de tissus ternes ils s’en dénudent peu à peu révélant leurs couches internes, colorées, leurs mouvements souples, puissants et tendres.
Des scènes se dessinent qui disent les dominations et les libérations. Celle d’un viol, brutal, sans regard complaisant, qui laisse la victime inerte dans les bras consolateurs de sa mère, est la plus violente ; mais tout aussi fortes sont celle de la transfiguration d’un homme qui se colore, s’assouplit et se féminise, ou l’épanouissement magique de la figure de la mère rendue belle, vivante, par ses enfants. La musique, à la fois joyeuse et grave, puissante et subtile, faite de loops et de samples vocaux, de souvenirs mélodiques et d’inventions, accompagne et précède souvent cette affirmation d’une confiance dans la force vitale, dans les paysages les plus arides, les histoires les plus sanglantes, les dénuements les plus extrêmes.
Destins jumeaux
À Klap, Hanin Tarek et Amina Abouelghar dansent en parallèle, ce qui est toujours fascinant. Les deux artistes égyptiennes, en un court duo, font la synthèse de gestuelles différentes, que les classements de la danse nommeraient orientale baladi, hip-hop waving, contemporaine slow motion… Exécutant la plupart du temps les mêmes mouvements, leurs corps pourtant assez similaires révèlent leurs différences, au creux d’un geste qui s’incurve différemment, d’une main qui s’ouvre davantage, d’un cou qui s’incline plus longtemps. Les deux femmes enchaînent dans des cercles de lumière, puis viennent saluer, un keffieh palestinien sur les épaules.
Au cœur de la tendresse
C’est à un voyage autrement émouvant que nous invite Malika Djardi. Si la relation des fils à leur mère est le sujet de la plupart des autobiographies, celle des filles est plus récente et s’inscrit rarement dans ces temps adultes où la mémoire s’éteint et où la disparition est proche. La mère de la danseuse chorégraphe était déjà au cœur de son spectacle précédent, qui alliait vidéo et performance : Marie-Bernadette, épouse d’un Algérien, convertie à l’Islam, est une mère courage attachante préservant ses enfants d’une famille raciste avec qui elle a coupé les ponts. On la retrouve ici en Ehpad, Martyre, malade d’Alzheimer, inventant des gestes, des danses, que sa fille attentive filme et reprend, comprend, et dont elle s’inspire pour sa danse. Les gestes échangés, mains qui s’étreignent, caresses sur une joue, rires et paroles, cœur qui se serre quand la mémoire disparaît trop vite, sont des moments d’une rare humanité. Le spectacle est trop long, la danseuse trop bavarde, mais Malika, enceinte, trace les lignes et les cercles, toujours au bord, d’une transmission de tendresse, de gentillesse, de bienveillance, d’amour, qui persiste au-delà de la maladie, comme une indélébile empreinte fondatrice. La musique joue aussi sur les souvenirs, de début de Schubert, d’un bout de Carmen, de chansons populaires. Une mémoire partagée qui reste, bribe sur bribe, la seule relation possible, encore et toujours désirée, d’une fille avec sa mère.
AGNÈS FRESCHEL