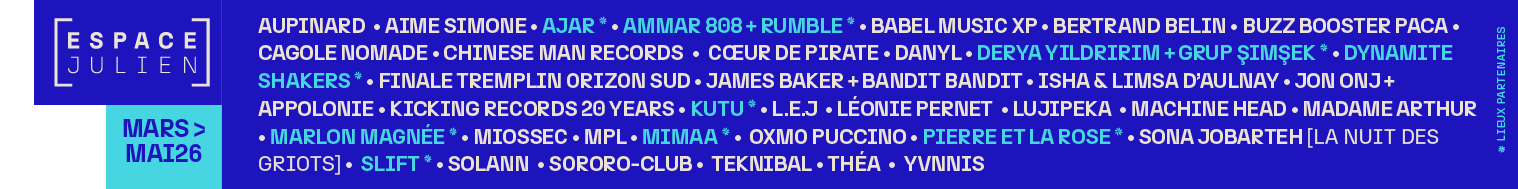Zébuline. Liebestod est truffé de références, la plus évidente étant celle à la tauromachie. L’art est-il un combat et le théâtre une arène ?
Angélica Liddell. Bien sûr, l’agone de la tragédie grecque est à la base de mes œuvres. Il me faut toujours travailler avec ce sentiment de danger intérieur. Je lisais Annie Ernaux l’autre jour et elle disait qu’elle avait toujours besoin d’écrire quelque chose qui était dangereux pour elle. Je comprends ce genre de danger. Le danger de l’aveu. Et il est certain que le seul pouvoir dont on puisse abuser est le pouvoir de la poésie.
Comme pour le torero Juan Belmonte dans l’arène, montez-vous sur scène avec l’envie de mourir ?
Cela se produit automatiquement. Tout le désir de mourir que je traîne depuis mon enfance se libère et me donne de la force. C’est pour cela que j’ai choisi la tauromachie comme métaphore de mon histoire du théâtre, et Juan Belmonte parce que c’est un torero qui a affronté l’art à partir d’une philosophie tragique. L’essentiel est d’ÊTRE, pas de PARAÎTRE. C’est le dilemme de Persona, dans le film de Bergman. On naît tout simplement ainsi.
Dans une société qui ne semble plus vous apporter beaucoup de bonheur, le théâtre est-il pour vous le plus supportable des sacrifices ?
Malgré le fait qu’au théâtre je me sens dans un corps qui ne m’appartient pas, cet abandon est ce qui donne un sens à ma vie. S’il n’y avait pas eu mon travail, je me serais tiré une balle, comme Belmonte quand il ne pouvait plus monter seul à cheval. Le théâtre pour moi, c’est aussi l’écriture, et je n’ai qu’un seul choix : l’écriture ou la potence. Le fait que le monde du théâtre, des acteurs, des danseurs, etc. me répugne, ne signifie pas que je n’aime pas mon travail. Bien qu’il m’arrive de le détester aussi, comme dans le film Les Chaussons rouges de Pressburger. Parfois j’aimerais être heureuse sans avoir besoin de travailler. Mais « les chaussons rouges » m’obligent à danser. Ils sont le diable.
Votre travail vous rend-il tout de même heureuse ?
C’est la seule chose qui me rend heureuse. Les films aussi. Et la peinture.
Vous êtes parfois dure avec le public. Avez-vous encore besoin d’un rapport direct avec lui ?
Je ne suis pas agressive avec le public, pas du tout. Cela signifierait que les personnages d’Oncle Vanya ou d’Hamlet sont durs avec le public. Ce n’est pas le cas. C’est tout le contraire. Je recherche la communion et la complicité du public. Je veux qu’il participe à mes haines. Je recherche l’amour du public, pas le rejet. Ma relation avec lui est pratiquement sexuelle. Je pratique la pornographie de l’âme.
Vous êtes considérée comme une artiste radicale et clivante. Cherchez-vous vraiment à l’être quand vous écrivez vos spectacles ?
Je ne cherche pas la provocation, seulement la limite de la pensée. Et surtout quelle partie de mon âme je veux livrer. Je suis une sorte de Sade à l’asile de Charenton. Grâce à la prison de la société, je libère mes souffrances et les transforme en cruauté esthétique. C’est un acte de liberté qui à son tour libère le spectateur.
Vous avez dit que les responsabilités démocratiques étouffaient l’expression artistique. Qu’entendez-vous par là ?
Je crois qu’il ne faut pas confondre la loi de l’État et celle de la poésie. Quand l’expression artistique se voit menacée par les discours politiques, cela me fait trembler. Je pense à la révolution culturelle maoïste qui a anéanti les arts. Je pense à Tarkovski et Paradjanov, exilés parce qu’ils n’obéissaient pas à une esthétique d’État. Je pense à la polémique au Met [The Metropolitan Museum à New York, ndlr], où ils voulaient retirer les tableaux de Balthus. Tout cela est une régression. Connaissez-vous la seconde mort de Maïakovski ? L’artiste, tel que l’explique George Steiner, évolue dans le décalage entre l’art et la vie civile. En tant que citoyenne, je suis résistante à la barbarie. En tant qu’artiste, je suis une tueuse. L’art, le crime et l’amour représentent l’impuissance de la raison. Et les discours politiques sont l’asservissement à la raison. Une servitude qui ne génère pas de pensée.
Est-ce donc l’artiste ou la citoyenne que l’on pourrait qualifier de réactionnaire ?
Ni l’une ni l’autre. Pasolini est une référence constante dans ma vie et dans mon œuvre, et personne qui a Pasolini comme référence ne peut être réactionnaire. Vous le savez ? Quand j’ai joué au Teatro Olimpico de Vicence, en Italie, j’ai dû entrer sous la protection de la police à cause des menaces des fascistes et des ultra-catholiques. J’ai même subi des menaces de mort. Aujourd’hui, ces fascistes sont au gouvernement italien. C’est ça le fascisme. Moi je veux simplement un monde plus beau et je suis horrifiée par la bêtise des bonnes intentions appliquées à l’art. Les œuvres ne sont pas appréciées pour leur qualité esthétique mais pour leur message, un message moral. En ce qui concerne l’esthétique, je défends l’immoral, car l’immoral dans l’art est éthique en soi. L’immoral éduque. Ce qui est moral nous rend stupides.
Vous donnez l’impression de ne pas avoir beaucoup d’estime pour vos contemporains. Avez-vous plus d’espoir dans les générations futures ou estimez-vous définitivement être une femme du passé ?
Pour moi, c’est un honneur d’être une femme du passé. Je ne m’intègre pas. J’aime les artistes du XXe siècle. Et cela m’ennuie de devoir mourir dans un siècle de merde comme le XXIe. Mais la foi dans les jeunes me fait tenir. Oui, je crois qu’arrivera une génération avec une puissance esthétique brutale, loin de toute cette avalanche de messages positifs et « motivationnels », de l’art de l’entraide. Viendra une génération de fous, d’artistes irresponsables, qui placeront la suprématie esthétique et le déséquilibre de l’être humain au-dessus de tout.
Dieu est-il la dernière personne que vous admirez ?
On parle à Dieu quand on ne peut plus parler à personne d’autre. Dieu est un besoin pour qu’il existe. Quand je parle de Dieu, je parle d’un monde où l’esprit triomphe de la matière. Vous souvenez-vous de cette phrase d’Ingmar Bergman ? « Dieu et l’amour c’est pareil, c’est comme un brouillard noir, et autant de fois que vous l’appelez, il ne répond jamais. » L’art est ce cri. Le mystique n’est rien d’autre que haïr la vie. Je veux que l’art ait la force de la religion. Ce sont ces dieux qu’il faut chercher. Dieu est l’inspiration. On pourrait dire que la beauté est toujours son portrait. C’est pour cette raison que je recherche inlassablement la beauté sur scène.
ENTRETIEN RÉALISÉ PAR LUDOVIC TOMAS
Liebestod s'est joué du 9 au 11 février
La Criée, théâtre national de Marseille
theatre-lacriee.com