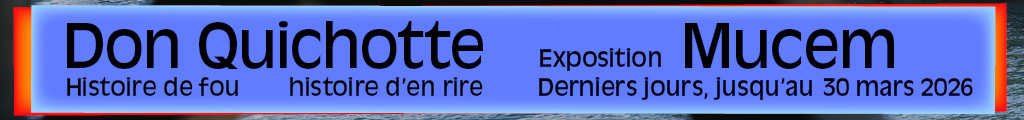Diasporik. Entre républicanisme et « wokisme », comment défendre une approche nuancée du décolonial ?
Stéphane Dufoix. La logique du « campisme » – choisir un camp contre l’autre – n’aide pas à comprendre. La perspective décoloniale n’est pas seulement militante : elle est aussi scientifique et politique. Prendre de la distance permet de voir comment ces camps se sont formés, et de mieux cerner les enjeux actuels.
Quelles médiations entre monde académique, luttes sociales et institutions ?
La perspective décoloniale permet de penser la production de savoirs au-delà du cadre universitaire. Les mouvements sociaux – du Chiapas aux forums altermondialistes – produisent eux aussi des connaissances sur la société. Leur circulation par chercheurs, médias ou intellectuels élargit le champ des possibles. La stricte séparation entre science et militantisme limite ces circulations et bloque les transformations sociales.
Quel rôle pour les citoyen·nes, notamment les personnes racisées, dans ce chantier ?
Nous restons prisonniers de structures mentales héritées du passé national : genre, couleur de peau, religion, origine. Toute personne peut contribuer à les déconstruire, mais celles et ceux qui vivent directement discriminations et exclusions disposent d’une capacité particulière à les objectiver. Leur expérience, transformée en récit, recherche, art ou mobilisation, enrichit la critique et ouvre des voies nouvelles.
Quelles transformations nécessaires au-delà du symbolique dans les institutions culturelles ?
Le chantier est immense. L’Éducation nationale devrait engager une réflexion d’ensemble sur l’histoire de France, intégrant pleinement esclavage, colonisation et immigration. Le Musée national de l’histoire de l’immigration illustre cette démarche. L’ouverture des archives sensibles, notamment celles de la guerre d’Algérie, va dans le même sens. Mais entre accès aux documents et mise en récit fidèle à la réalité historique, il reste un long chemin.
« La perspective décoloniale n’est pas une idéologie, c’est un outil critique pour comprendre et transformer nos sociétés. »
Comment les sciences sociales françaises intègrent-elles (ou résistent-elles) à la critique décoloniale ?
25 ans après leur émergence, les travaux du collectif Modernité/Colonialité restent peu traduits et mal diffusés en France, malgré l’effort de chercheur·es comme Philippe Colin, Lissell Quiroz ou Capucine Boidin. Deux raisons principales : la disciplinarité universitaire, peu adaptée à une approche transversale, et le poids d’un universalisme français qui, depuis les années 1990, a pénétré le monde intellectuel. Les recherches critiques sont souvent disqualifiées comme « idéologies » – islamo-gauchisme, wokisme, intersectionnalisme – plutôt que débattues sur le fond.
Vous évoquez souvent le pluriversalisme. En quoi éclaire-t-il les résistances françaises ?
L’universalisme politique, hérité des Lumières, est une construction historique. La France, comme les États-Unis, s’est pensée investie d’une mission : hier la « mission civilisatrice », aujourd’hui une certaine idée de l’exception française. Mais universaliser un point de vue particulier revient à le déshistoriciser. D’où l’appel de Dipesh Chakrabarty à « provincialiser l’Europe ». La critique de ce faux universalisme ne signifie pas forcément relativisme. Le pluriversalisme, tel que défendu par Walter Mignolo ou Arturo Escobar, s’inspire de l’idée zapatiste d’un monde « où coexistent de nombreux mondes ». Il affirme une universalité de la pluralité.
À Marseille, les diasporas portent des démarches décoloniales, parfois en opposition aux institutions. Qu’en pensez-vous ?
La logique diasporique et l’approche décoloniale ne se confondent pas, même si elles convergent dans la contestation d’un récit national unique et exclusif. Les diasporas construisent des espaces communautaires, selon des appartenances vécues. Le projet décolonial, lui, vise un horizon plus large : transformer les cadres collectifs du vivre-ensemble.
ENTRETIEN RÉALISÉ PAR SAMIA CHABANI

Nos articles Diasporik, conçus en collaboration avec l’association Ancrages sont également disponible en intégralité sur leur site