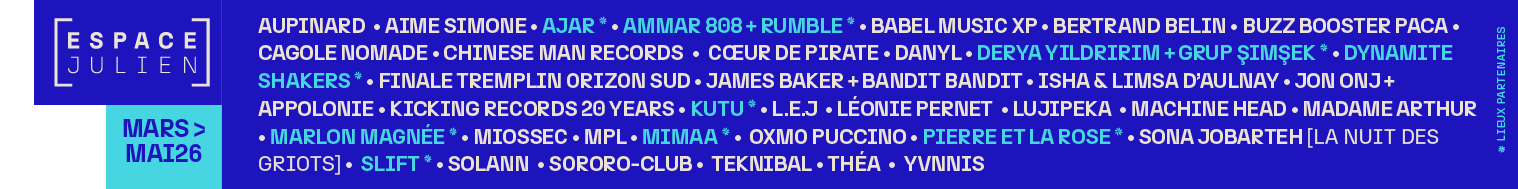Les trois soirées du festival s’articulaient chacune en deux temps, un artiste jeune déjà solidement confirmé puis une légende.
Hymne à la liberté
Le guitariste allemand surdoué Henrik Freischalader ouvrait le bal avec ses complices Moritz Fuhrhop (orgue Hammond), Armin Alic (basse), Hardy Fischötter (batterie). « Le blues est pour lui plus que de la musique, c’est sa vie », souriait le directeur artistique André Carboulet. Sur scène, la technique somptueuse du musicien se joue des sonorités rétro-70, se mariant avec une voix émouvante pour un blues intemporel qui ne néglige pas la joie de la danse même lorsqu’elle dit « my baby don’t love me no more ».
Le soir suivant, Nikki et Jules, traduisez Nicolle Rochelle (chant, danse) et Julien Brunetaud (pianiste génial), apportaient leur verve et leur humour accompagnés de Sam Favreau (contrebasse), Cédrick Bec (batterie) et Jean-Baptiste Gaudray (guitare). Leur propos abordait le « deuxième versant de la grande vague du blues : boogie-woogie, rhythm and blues… ». La vivacité des utopies berce ces musiques généreuses. Le lapstick (cette étonnante petite guitare) de Laura Cox permettait un hommage à la musique country qui l’a nourrie avant de décliner un rock addictif qui flirte parfois avec les inflexions du groupe Popol Vuh (qui a tant composé pour le réalisateur Werner Herzog). Toute fine sur scène, la jeune guitariste et chanteuse impose une présence forte qui dynamise ses musiciens, Antonin Guérin (batterie), Adrien Kah (basse et chœur), Florian Robin (claviers).
Le temps des légendes

Le pionnier de l’harmonica en France, Jean-Jacques Milteau, s’amuse aux traversées transatlantiques des musiques. Et comme « l’ensemble est supérieur aux parties », il réunit autour de lui, outre ses instrumentistes, Jérémy Tepper (guitare), Gilles Michel (basse), Eric Lafont (batterie), deux chanteurs aux voix opposées, l’un ancré dans la terre et les rocailles, l’autre tutoyant les nuages, Michael Robinson et Ron Smyth qui offrirent des duos sublimes où chaque timbre enrichissait l’autre. Le blues retrouve ses racines gospel, arpente les titres des albums. Le guitariste et chanteur Tommy Castro annonçait : « It’s party time tonight » et enchaînait ses tubes, The pink lady, That girl, Blues prisoner, avec un sens très théâtral en une plongée vertigineuse dans le grand bleu du blues.
Le festival se refermait en pyrotechnie avec Sugaray Rayford, géant de la scène, endroit où il se sent chez lui, présent dès le changement de plateau, blaguant avec les techniciens et ses musiciens, s’adressant au public comme à des amis. La chaleur humaine est aussi une histoire de blues avec un orchestre éblouissant, (« ils peuvent jouer n’importe quoi » affirme Sugaray, exemples à l’appui), guitare stratosphérique de Daniel Avila, trompette (Julian Davis), sax (Derrick Martin), batterie (Ramon Michel), basse (Allen Markel) imperturbables malgré les frasques espiègles de Sugaray dont le chant conte, s’indigne, prend des allures de prédication des églises américaines, confie. On n’oubliera pas de sitôt la reprise par Robert Drake Shining aux claviers et au chant du célébrissime Comfortably Numb (The Wall, Pink Floyd), ni de l’intervention impromptue en « guest star » de l’épouse du bassiste, feu follet à la voix bigrement groovy, ni le dernier chant, a cappella, de Sugaray, assis sur une caisse, face au public, un What a wonderful world (Louis Armstrong) qui nous rappelle combien l’art est capable de rapprocher les mondes et de lutter pour la paix.
MARYVONNE COLOMBANI
Le Blues Roots Festival s’est tenu du 7 au 9 septembre au domaine de Valbrillant, Meyreuil