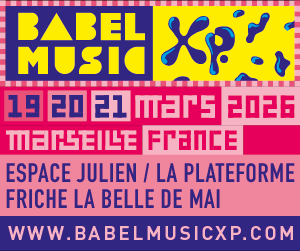Que faire aujourd’hui de la salomania et de son culte un brin défraîchi de femme fatale ? Au sujet de Salomé, fascinante coupeuse de tête, la metteuse en scène bavaroise Andrea Breth ne tarit heureusement ni d’idées, ni d’amour. Grand bien a pris à ce pilier du théâtre allemand, qui fut entre autres la première femme nommée à la tête de la Schaubühne, de s’y atteler. Et de compter, pour cette production, sur la voix et la présence scénique d’Elsa Dreisig, que l’on pensait à tort trop légère, trop mozartienne pour ce rôle si exigeant.
Car il faut bien admettre que la performance de la soprane franco-danoise relève du prodige : la partition, pourtant rude et ample, semble d’une simplicité désarmante. La pureté surréaliste de son timbre et la souplesse ahurissante de son instrument contrastent brutalement avec la sauvagerie de l’Orchestre de Paris, qu’Ingo Metzmacher fait tour à tour rugir, trembler, danser avec grâce…

De l’ô dans le gaze
Cette Salomé d’une blancheur immaculée se fait, malgré elle, astre d’une nuit sans fin. Celle-ci se mue en cène de pacotille, table de banquet vidée de victuailles, ou en terre volcanique, lieu d’éruption du désir. La jeune princesse sort, conformément au livret, à peine de l’enfance : tout juste sait-elle se distinguer de sa mère, Hérodiade. Autre brillante idée : cette mère bafouée par son mari est interprétée avec une délicatesse émouvante par Angela Denoke, qui incarna elle-même Salomé à plusieurs reprises et cale joliment ses interventions sur celles de sa jeune partenaire. Étouffé par la violence mortifère de son environnement, le désir naissant de cette Salomé adolescente est impossible à assouvir. Il ne peut que se faire pervers, morbide : et ce d’autant plus parce qu’il se dirige vers l’incarnation même de la pureté. Soit Jochanaan, aussi fade et pédant que la voix de Gabor Bretz est riche et ancrée. Bien que visiblement moins intéressée par ses protagonistes masculins que par ses figures féminines, Andrea Breth nous gratifie cependant d’un Hérode nuancé, là où d’autres l’auraient volontiers dépeint en beau-père libidineux. John Daszak l’incarne avec le même mélange de majesté et de naïveté, fort d’un ambitus à rallonge et d’un volume particulièrement impressionnant. Les quelques ralentis superflus et surtout les choix de lumière et de floutage par le rideau de gaze, figurant les sept voiles que Salomé ne retirera pas, ou encore le passage obligé de l’abattoir pourront sembler un peu vieillots. Mais la sincérité et la cohérence du projet l’emportent, très largement.
SUZANNE CANESSA
Salomé de Richard Strauss a été donné du 5 au 19 juillet au Grand Théâtre de Provence dans le cadre du Festival d’Aix-en-Provence.