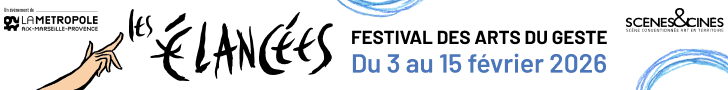Le 15 septembre, devant une salle comble, le cinéaste François Ozon et son acteur, Benjamin Voisin sont venus présenter au cinéma Les Variétés à Marseille l’adaptation du roman de Camus, L’Etranger ; Zébuline les a rencontrés.
La parole au cinéaste
Depuis l’adaptation de Visconti en 1967 personne n’a osé transposer au cinéma L’Etranger. Qu’est ce qui vous a donné cette envie ?
Plein de gens ont essayé et se sont cassé les dents. On m’a dit : « C’est un livre inadaptable, un livre philosophique. Il y a une trame narrative au premier degré mais ça raconte des choses sur la relation au monde, sur la place de l’homme dans le monde. Je me suis lancé de manière un peu insouciante. Je me suis dit que je m’attaquais à un monument de la littérature française et je me suis rendu compte que c’était compliqué. J’ai eu les droits car la fille de Camus, Catherine Camus m’a fait confiance, a compris l’adaptation que je voulais faire : pour moi, c’était important de faire le film avec les yeux d’aujourd’hui. Depuis 1942, il s’est passé beaucoup de choses entre la France et l’Algérie et il me semblait important d’intégrer ça dans le regard sur cette histoire , de contextualiser et raconter aux spectateurs d’aujourd’hui ce qu’était l’Algérie française, des choses du passé que beaucoup ont oubliées et dont on parle très peu. Pour moi, c’était important de commence le film par ces images d’archives qui expliquent comment les Français voyaient l’Algérie française. A partir de là, l’histoire pouvait commencer
Il y a eu une adaptation turque en 2001 de Zeki Demirkubuz ou plutôt une transposition dans la Turquie contemporaine. Vous avez choisi de rester très proche du roman. Comment avez-vous travaillé ?
Il y a cette contextualisation et la volonté de développer des personnages féminins. Le personnage de Marie que je trouve très « décorative » dans le livre, je l’ai rendue un peu consciente de ce qui se passe. Pour moi, c’était important après avoir lu le livre de Kamel Daoud, Meursault contre enquête : il y est question du frère de l’Arabe. La femme est frappée par Raymond Sintès et je me suis dit : Qui est cette femme ?; et j’ai imaginé ce personnage. C’était important pour moi, qu’elle donne la parole aux Arabes qui ne l’ont pas et n’ont pas de nom dans le livre.
Dans le livre de Camus, les femmes n’ont pas la parole. C’est un monologue intérieur ; elles n’existent pas en tant que Personnages. Il y a une pensée philosophique, abstraite. Comment avez- vous articulé cela ?
C’est un équilibre entre les deux. En fait quand j’ai lu le livre, je me suis dit que ce livre était un mystère parce qu’il est universel. Il est universel parce qu’il nous échappe. Je pense que les chefs d’œuvre peuvent être interprétés de manière très différente. Chacun a sa vision de Meursault. Je me souviens que lorsqu’on a montré les premières images du film, certains ont dit que Meursault n’était pas cela. Dans le livre, il n’est pas décrit. Chacun a imaginé cette histoire dans sa tête et l’a mise en scène ! C’était compliqué ! Et la pensée de Camus ! Je ne suis pas du tout philosophe mais j’étais passionné. J’ai lu toute sa pensée : j’ai relu Le Mythe de Sisyphe, j’ai lu ses descriptions de l’Algérie. Je me suis nourri de son univers et j’ai essayé de traduire sa pensée. Le livre a quelque chose d’un peu nihiliste à la fin mais quand on discute avec des spécialistes de Camus, ils nous disent que Camus, c’est L’Homme révolté, c’est la révolte. D’où la dernière scène avec le prêtre où il explose, exprime ses émotions et dit « J’ai été heureux. » Il est capable de ressentir le moment présent et se rend compte qu’il a été heureux.
Vous citez même par le fantôme de la mère des réflexions sur la guillotine et la peine de mort sur laquelle Camus a beaucoup écrit…
Oui, c’est important que la mère soit incarnée, la mère dont tous les lecteurs parlent car c’est la première phrase du roman. Je savais que tout le monde m’attendait au tournant. J’ai détourné le piège en commençant par une phrase du livre qui est dans la deuxième partie quand il arrive dans la prison, qu’on lui demande ce qu’il a fait et qu’il répond : « J’ai tué un Arabe ». Et commencer le film ainsi me permettait de donner une vision sur la sœur. En 1942, commencer le livre par « Aujourd’hui, Maman est morte » c’était révolutionnaire. Aujourd’hui, c’est moins surprenant. « J’ai tué un Arabe » est plus choquant pour le spectateur.
Dans le roman, le personnage de Meursault est énigmatique et on a du mal à le cerner. Il le reste dans votre film. Pour l’incarner, Benjamin Voisin qui incarnait David Gorman, un jeune homme solaire dans Eté 85. Avez-vous pensé à lui tout de suite ?
On avait un autre projet ensemble qu’on n’a pas réussi à faire et très vite, j’ai pensé à lui parce qu’en fait, en lisant beaucoup d’interviews de Visconti, sur son film, j’ai appris qu’il n’aimait pas son film, produit par Dino de Laurentis, et surtout le casting. On lui avait imposé Mastroianni alors que son choix était Delon. L’Alain Delon de Samouraï et de Plein soleil correspondait beaucoup mieux. C’est bizarre de voir Mastroianni jouer Meursault : avec son coté nonchalant, méditerranéen, il ne correspondait pas vraiment au personnage mutique. Moi, j’avais l’impression que puisque c’était un personnage pour lequel, on n’a pas d’empathie, il fallait jouer sur une forme de fascination. Il fallait un acteur mystérieux, avec une force intérieure, beauté et sensualité. La sensualité, c’était très important pour Camus et j’ai tout de suite pensé à Benjamin. Le filmer en noir et blanc fonctionne bien, me semble t-il
Comment l’avez fait travailler ? Que lui avez-vous donné comme direction de jeu ?
Je lui ai donné à lire Notes sur le cinématographe de Bresson qui ne parle pas des acteurs mais des modèles. Je lui ai demandé de s’abstraire, de ne pas avoir de réactions, d’être dans son monde intérieur. C’était très compliqué pour ses partenaires qui disaient : « Qu’est ce qu’il est désagréable ! » Il était vraiment ce personnage.
L’articulation entre la vie, la sensualité et l’aridité d’une thèse philosophique, se fait par la lumière. Le traitement de la lumière nous impressionnées. C’est ce qui façonne le récit…
Le soleil est très important pour Camus : c’est le plaisir et ça tue. On a tourné à une période où il n’y avait pas tout le temps du soleil et c’était un peu compliqué. On a fait beaucoup d’essais avec la caméra, pour voir comment filmer avec la pellicule, voir comment rendre la chaleur et le coté aveuglant de cette lumière du soleil. On a tourné au Maroc parce qu’on ne pouvait pas tourner en Algérie. En général, quand on veut décrire Alger à cette époque, on tourne à Tanger. Il y a beaucoup de documents dont on a pu s’inspirer. Je ne connais pas l’Algérie mais on m’a dit qu’on avait vraiment l’impression d’être à Alger.

La parole au comédien, Benjamin Voisin
Quand François Ozon vous a proposé d’incarner Meursault, quelle a été votre réaction et ce personnage si particulier vous a-t-il fait peur ?
On avait le projet d’un film avec François (Ozon) qui ne s’est pas fait pour différentes raisons : c’était un film en trois parties dont une sur un jeune homme un peu désillusionné un peu hors de l’humanité et qui avait un penchant suicidaire. Puis il a relu de son côté l’Etranger et on en a parlé ensemble. Moi c’était un de mes bouquins préférés et dans la continuité des choses on s’est dit pourquoi pas l’imaginer au cinéma. Il a écrit une première version de scénario et voilà. Donc moi je n’ai pas intégré ce film de manière normale. Les choses sont arrivées sans le coup de fil un peu violent « je pense à toi pour ce rôle ». J’étais là. J’avais déjà en tête le jeune homme dépressif du projet initial. Glisser dans le rôle de Meursault, ça s’est fait dans une forme de continuité. Après non, je n’ai pas eu peur. J’ai peur quand je monte sur scène et que j’entends la rumeur du public, mais jamais des échéances cinématographiques qui m’exciteraient plutôt. J’adore les responsabilités et j’étais heureux de donner mon corps à Meursault et ma version du personnage
Vous avez dit que L’Etranger était l’un de vos livres préférés : en tant que lecteur, imaginiez-vous Meursault sous vos traits ?
Non, si je pouvais m’imaginer en Raskolnikov ou en Lucien de Rubempré, je ne m’identifiais pas du tout au héros de Camus : je l’imaginais plus vieux. En plus, je suis d’un tempérament, très éloigné du caractère premier du jeune Meursault. Plus extraverti, plus dilettante. J’ai travaillé ce personnage sous la surveillance de François qui ne dirige pas beaucoup et se contente de dire oui ou non. C’est Pialat qui disait que 70% de la direction d’acteur, c’est du casting. Et c’est vrai, après ce n’est pas seulement choisir la bonne personne mais c’est encore lui faire confiance pour le trajet qu’il va parcourir de son côté en préparation, en documentation, en rêverie. Et voilà j’ai travaillé et je me suis un peu décalé de moi-même.
En même temps Meursault est un personnage insaisissable dans le roman, comment s’en saisit-on ?
Ben, c’est très dur. C’est très abstrait. J’avais un déclic et j’essayais de voir avec les gens ce qui se passait en étant Meursault. Ça met une tension terrible dans la vie normale : on ne donne pas de réponses, on revient à quelque chose de plus sombre et absurde, on nait, on vit, on meurt. Et je guettais dans leurs yeux ce que moi j’avais ressenti à la lecture du livre.
En jouant l’Etranger, avez-vous découvert des choses qui vous avaient échappé à la lecture du roman ?
Oui, j’ai mieux compris la philosophie de Camus. Tout peut être oui, tout peut être non. Quand j’entendais Rebecca Marder qui me disait : « Mais tu m’aimes ? » et ma réponse : « ça ne veut rien dire », un mois avant, pour moi, ce n’était qu’un texte. Au moment du tournage, c’était vrai ! C’est vrai que ça ne veut rien dire « Je t’aime »
Comment l’Etranger paru en 1942 peut-il être perçu par les Jeunes d’aujourd’hui ?
Je crois que les jeunes redoutent l’image qu’ils renvoient aux autres, cherchent l’approbation. Les vidéos postées sur les réseaux contribuent à ce conformisme. Meursault leur propose l’image de quelqu’un qui n’est pas ému par ce que pense la société, qui ne joue pas le jeu imposé par le collectif, qui reste vrai et qui malgré tout, devant la mort, sait qu’il a été heureux. C’est quelqu’un qui est normal, qui n’est pas marginal mais qu’on pousse vers la marginalité.
Est-ce qu’il y a eu des séquences qui ont été particulièrement difficiles à tourner ?
La séquence de la prison à la fin quand l’aumônier (Swann Arlaud) vient voir le condamné et où tout éclate et dans la confusion, prend sens. François voulait de l’émotion. On l’a tournée de 15 manières différentes, en riant, en pleurant, en criant, en hurlant. Le montage a retenu un peu de chaque manière. Mais je peux vous dire que j’ai bien dormi après !
Entretien réalisé par Elise Padovani et Annie Gava
L’Etranger sort en salles le 29 octobre
© A.G.