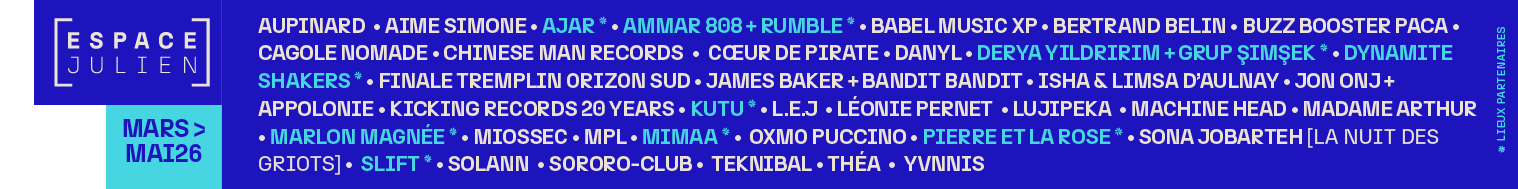Zébuline. Lors de la sortie de votre dernier album DNA, en 2019, vous affirmiez que vous ne vous étiez jamais sentie aussi bien dans la vie. Pour quelles raisons ?
Flavia Coelho. J’allais avoir 40 ans et je sentais que plein de belles choses m’arrivaient. On connaît la suite… Mais pour parler de manière générale, je suis quelqu’un d’optimiste malgré tout le pessimisme qui existe autour de nous. Le monde va mal, il faut le reconnaître. J’essaie de coller des fragments de bonheur par-ci, par-là pour résister. J’ai aussi la chance de vivre de ma musique et c’est un cadeau dont j’ai conscience tous les jours.
N’est-ce pas aussi la maturité à la fois artistique et personnelle qui permet cette façon de s’épanouir dans un monde qui n’est pas très joyeux ?
Cela aide un peu et en même temps, j’ai l’impression que plus on vieillit, plus on perd le côté ludique de l’enfance. Alors j’essaie de l’entretenir. J’ai 42 ans et je suis heureuse d’être en bonne santé, de pouvoir jouer des instruments, d’utiliser mon regard, ma parole… et de donner un peu de bonheur à ceux qui écoutent ma musique.
Vous avez enregistré quatre albums en moins de dix ans que vous avez défendus et continuez de défendre sur scène sans quasiment d’interruption. D’où vient cette énergie ?
Cela vient de plein de petites choses de la vie et surtout de pouvoir vivre et m’épanouir de mon art. J’ai commencé la musique à l’âge de 14 ans, dans un pays très patriarcal. À l’époque, c’était plus compliqué qu’aujourd’hui de devenir chanteuse. J’ai grandi au sein d’une famille modeste et assez religieuse. Au Brésil, les castes sont assez claires. Quand on est pauvre, on est pauvre. On n’a pas vraiment le droit de dépasser ce seuil. J’ai réussi à m’extirper de tout ça et construire mon chemin comme je le voulais. Ça m’a donné de la force. C’est important de regarder d’où l’on vient, de se rendre compte de son parcours.
Même en France, il vous a fallu de la patience et de la détermination pour mettre votre carrière sur les rails sur lesquels elle est aujourd’hui.
C’est le parcours que nous connaissons tous un peu quand on choisit de vivre de sa passion. C’est un métier dont on n’est jamais sûr et qui dépend exclusivement de soi-même. Il faut déjà trouver ses bases pour créer quelque chose et par la suite trouver des collaborateurs, toute la machine qui fait que le projet puisse avancer, convaincre un maximum de personnes que ce qu’on est en train de faire est bien… J’ai vu les difficultés que cela représentait de chanter dans une autre langue. Mais je suis quelqu’un de passionné qui ne lâche pas le morceau.
Que retenez-vous de la dernière élection présidentielle au Brésil ?
C’est un soulagement que Lula soit de retour. Je l’aime de tout mon cœur et souhaite le meilleur à ses équipes. Une énorme blessure a été ouverte et le pays est partagé en deux. Il reste beaucoup de boulot à faire et il faudra quelques années pour guérir les stigmates du gouvernement précédent.
Le clivage existait auparavant. Il a été juste accentué, appuyé avec l’arrivée de Bolsonaro. C’est ce que font les extrêmes droites partout : donner de la voix à des personnes qui n’ont pas le courage de dire leurs conneries.
Vous vous produisez à Marseille, au Makeda, pour une soirée spéciale 8 mars. Cette journée internationale pour les droits des femmes est-elle importante pour vous ?
J’étais déjà touchée par ces questions-là dans mon pays. Même si c’est un peu plus simple pour moi aujourd’hui, je vois bien le nombre de femmes en tête d’affiche dans les festivals. On n’est pas encore tout à fait dans la parité ! Il faut continuer à se battre en organisant des événements comme celui du 8 mars au Makeda. Aude et Francine [les cofondatrices du lieu, ndlr] essaient de mettre au maximum en avant les projets artistiques féminins. Pour moi, c’est très important d’avoir ce rendez-vous annuel à Marseille et de partager une scène 100 % féminine et revendicatrice.
ENTRETIEN RÉALISÉ PAR LUDOVIC TOMAS
Flavia Coelho était en concert le 8 mars avec Karimouche et Soul Sliders au Makeda, Marseille
lemakeda.com