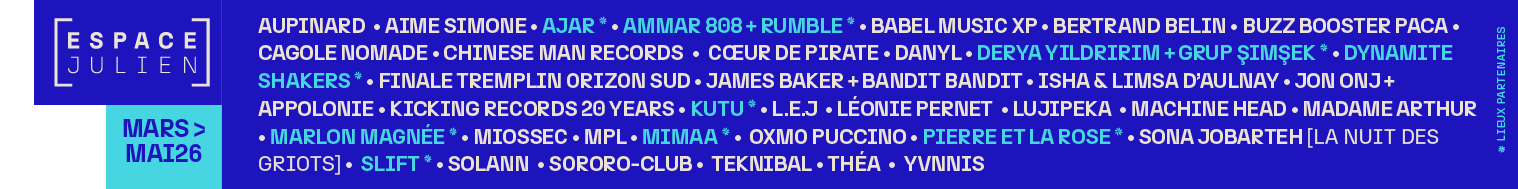Elle me dit
C’est cette anaphore scandée avec moins de colère que de lassitude par Samir Laghouati-Rashwan qui reste à l’esprit et hante encore le spectateur, une fois la performance On vous voit achevée. Ce « elle me dit » qui précède les propos de plus en plus inacceptables d’une femme, ou sans doute de plusieurs autres, à l’encontre d’un corps d’homme exotisé, fétichisé. Ce corps pourrait être celui auquel l’artiste performeur donne voix. Ou bien peut-être s’agit-il de celui du danseur Trésor, esquissant des pas de plus en plus amples, gonflés par la rage et la peur. La voix amplifiée, enregistrée, décuplée, multiplie ces compliments qui n’en sont pas, qui intiment à l’homme de séduire en adoptant les codes d’un virilisme de pacotille. « Je rentre skin, je mets mon masque player, je joue le jeu » : cette ritournelle érigée en guise de réponse semble s’effriter, de même que le masque de masculinité requis. Efficace et frontal sans jamais tomber dans l’excès.
Samba Triste
On pourra regretter que la « Cérémonie d’ouverture » pensée par Juliette George et Joseph Perez, avec la complicité de Clément Douala, se soit vue attribuer le rôle non pas d’introduction, mais de transition, entre ce On vous voit décapant et le très attendu O Samba do Crioulo Doido. Le texte et l’écriture, assez savoureux, semblant s’éparpiller dans l’enceinte peu indiquée des grandes Tables de la Friche. Donnée enfin au grand plateau, la pièce dansée de Luis de Abreu a quant à elle récolté une standing ovation. Créée il y a près de vingt ans par le chorégraphe, c’est désormais par le formidable Calixto Neto qu’elle est interprétée. Elle demeure l’un des plus brillants réquisitoires contre le traitement des corps noirs au Brésil jamais dansés. Techniquement virtuose, O Samba do Crioulo Doido détourne avec une intelligence, un humour mais également une rage salutaires les codes du carnaval brésilien : bottes aux talons vertigineux, sourires ultra brite, petits pas à contretemps, déhanchés et jeux de bras … Tout en les entremêlant avec des éléments de langage crus et dérangeants. Un chef-d’œuvre dont on peut cependant regretter qu’il semble, aujourd’hui encore, d’une brûlante actualité.
Promises et prometteuses
Il n’est plus rare que des artistes formé·es aux disciplines du spectacle vivant empruntent d’autres voies créatives. Parfois en dépit de leur intention initiale. C’est le cas de la chorégraphe Marion Zurbach, enfant de Martigues, dont le projet Les Promises, imaginé pour la scène, s’est conclu sur un écran, le Covid ayant compliqué les choses. Peut-être l’œuvre y a-t-elle gagné ? On ne le saura jamais. Toujours est-il que le résultat filmé par la réalisatrice Giulia Angrisani donne à cette expérience artistique collaborative une dimension poétique inattendue. Pendant deux ans, accompagnées par des artistes dont Arthur Eskenazi, des travailleur·ses sociaux·ales et des anthropologues Amira, Rachel, Fatima, Ilhem, Minane et Djenna ont écrit cette performance documentaire, puisant dans la spontanéité de leur vie d’adolescentes des 15e et 16e arrondissements de Marseille. À travers la danse, la fringue, les réseaux sociaux, le jeu, l’écrit aussi, elles mettent en scène, avec une liberté de ton et d’action – que l’on imagine acquise au fil du processus – leur quotidien, réel ou imaginaire, de jeunes femmes françaises des années 2020. Qu’elles s’imaginent le jour de leur mariage, en train de faire un tour du monde ou dans le rôle de garçons dont elles parodient les postures, ces Promises crèvent l’écran par leur hargne à s’inventer un avenir. Parce qu’elles parlent depuis les quartiers populaires, qui plus est ceux du Nord de Marseille, elles donnent à leur récit truffé d’humour et d’autodérision une force naturelle capable de soulever des montagnes. Loin de tout déterminisme ou misérabilisme.
Dalida, es-tu là ?
Il fallait vraiment avoir confiance dans la programmation du festival pour choisir de s’enfermer, cinq heures durant, dans l’auditorium du Mucem un dimanche après-midi ensoleillé, afin d’assister à la conférence performée de Christodoulos Panaytolou, Dying on Stage. En près de 90 vidéos piochées sur YouTube, l’artiste chypriote déroule une brillante analyse personnelle sur les représentations de la mort dans le monde des arts et du spectacle. Des derniers saluts d’un Rudolf Noureev terriblement amoindri par le sida, quelques semaines avant son décès, à l’Opéra de Paris à l’occasion de sa version du ballet La Bayadère, à l’ultime concert d’une Amy Winehouse qui n’est plus que le fantôme d’elle-même. Sans oublier l’éternelle Dalida dont les interprétations scénographiées laissent parfois transparaître la vie « insupportable » à laquelle elle mettra un terme, abandonnant son vœu de « mourir sur scène ». Panaytolou parvient à nous émouvoir avec des images d’inconnu·es : celles d’une cantatrice à la carrière écourtée qui ne peut contenir ses larmes en réentendant sa voix, celles de fans d’Adèle ou Lady Gaga dont l’existence semble prendre sens à travers le dévouement à leur idole. L’électrocution filmée en direct d’un éléphant aux premières heures du cinématographe nous glace par ce qu’elle dit du fantasme humain sur la mise en scène de la mort. Même si le « conférencier » s’éloigne parfois du sujet initial, la pertinence de ses enchaînements nous y ramène de manière détournée et subtile. En nous faisant sourire souvent. Peut-être parce que la mort est au centre de la création depuis qu’elle est incarnée sur un plateau.
SUZANNE CANESSA
LUDOVIC TOMAS
Le festival Parallèle s’est déroulé du 19 janvier au 4 février, dans divers lieux à Marseille et Aix-en-Provence.