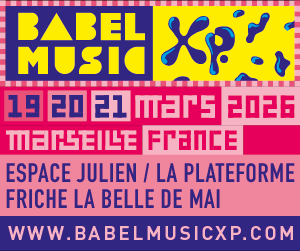L’arrivée de la flamme à Marseille a dépassé les espérances et confirmé la singularité et le succès de la cité phocéenne aux yeux de la nation et du monde. L’image de la ville corrompue, décatie, déclinante, dangereuse, sans nom, incapable d’affronter ses horizons marins comme son ancrage provençal, semble effacée, pour ne conserver que les traits positifs qui la caractérisent aussi dans l’inconscient national : populaire, conviviale, festive, accueillante et belle.
Bien sûr, on peut s’interroger sur les impacts écologiques de la Patrouille de France, des immenses feux d’artifices sur l’eau, des équipes de télé et de sécurité, et les frais de transports de chacun. Est-il raisonnable de proposer encore des grands événements aussi polluants ? La question amorce l’idée d’un renoncement souhaitable aux grandes fêtes populaires live ou télévisées, qu’elles célèbrent la flamme olympique, l’Eurovision, le 14 juillet, le Festival de Cannes ou les carnavals. Habitués à des débauches de lumières, de son et de paillettes et de bulles, devons-nous apprendre à nous en passer, ou à les penser plus sobrement ?
Un autre cérémonial est possible
Nous avons peut-être, à Marseille, assisté au dernier des « grands événements » d’un autre temps, et au début d’une autre époque. Une fête gratuite, alors que la polémique sur le prix des places de la cérémonie d’ouverture enfle. Une journée où la flamme oublie son apologie de l’excellence pour être portée par des corps de tous âges et de toutes couleurs, résistants, intellectuels, travailleurs sociaux, héros et héroïnes du quotidien. Où la foule se presse au côtés de chanteurs populaires tandis que le Président écoute un orchestre qui interprète, avec brio, un hymne d’une rare pauvreté mélodique. Où la culture populaire fait un pied de nez au Palais du Pharo, où Gaston Crémieux et la Commune furent exécutés, pour s’exprimer au bas de la Canebière, grande artère symbolique et populaire, lieu de tous les rassemblements revendicatifs. Indéniablement le peuple s’exprime, et on ne reviendra pas en arrière.
Reste le problème du coût et du profit. La puissance publique ne peut-elle organiser de telles cérémonies sans faire appel aux sponsors du très contestable Coca-Cola ou des banques du groupe BPCE ? La privatisation de l’espace et de l’imaginaire collectif est-elle inéluctable ? Si elles dictent leur loi, quelle culture populaire les entreprises vont-elles fabriquer, afin qu’elle leur rapporte ?
Dans notre société de communication capitaliste, il s’agit toujours de promouvoir une marque : celle d’une boisson polluante et trop sucrée, ou d’une destination touristique et économique. Celles de rappeurs marseillais devant la mer, ou d’un drapeau national dans le ciel. Comment faire autrement ? Sans doute en continuant de croire qu’une culture publique, qui ne promeut qu’elle-même, est possible.
AGNÈS FRESCHEL