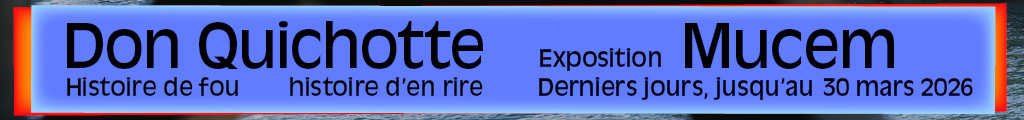De la mémoire révolutionnaire au polar social marseillais, en passant par la poésie d’Aragon mise en musique, ces rencontres célèbrent une littérature militante, de celle qui ne renonce jamais au combat. Le 12 décembre à 18 heures, ouverture du bal avec Guillaume Quashie, historien et auteur de Haro sur les Jacobins, Essai sur un mythe politique français (XVIIIe-XXIe siècle).
Dans cet ouvrage qu’il présentera, Quashie interroge la manière dont la mémoire révolutionnaire est aujourd’hui instrumentalisée, occultée ou réinventée. Comment les figures jacobines, ces révolutionnaires radicaux de 1793, sont-elles devenues tantôt des épouvantails, tantôt des icônes que l’on invoque à tout propos ? Que sont donc ces fameux jacobins ? Ont-ils seulement existé ? s’interroge l’auteur, qui est parti à leur recherche pour les étudier dans leur époque et comprendre les références polémiques dont ils sont depuis l’objet.
Le lendemain, la matinée sera consacrée à la rencontre avec des auteurs témoignant de la vitalité de la création littéraire régionale. L’occasion de préparer ses cadeaux de Noël en faisant dédicacer les livres par des auteur·rices en chair et en os. Parmi eux Martine Gärtner, dont les romans sociaux ont pour cadre une Allemagne où elle a enseigné vingt ans ; Bernard Ghirardi, connu pour ses ouvrages retraçant l’histoire locale ; Edmond Purguette, auteur du roman Drôles de bestioles (2022) qui s’inspire de son vécu dans l’enseignement et décrit des destins parfois difficiles d’adolescents. Mais encore Robert Rossi, trublion rock – il est le chanteur de Quartiers Nord – et historien qui a écrit une histoire de la Commune à Marseille et raconte dans ses livres les marges et les oubliés.
On discutera aussi avec la poétesse Marine Saint-Persan et Laetitia Vivaldi, auteure du livre Les âmeutés, qui évoque la résistance d’un peuple face à un capitalisme destructeur. Seront aussi présents les « polardeux » qui interviendront l’après-midi durant la rencontre Massilia noire.
Le polar comme arme sociale
Celle-ci réunira sept figures du genre. Florence Brémier, qui écrit pour la jeunesse, le Martégal Jean-Claude Di Ruocco, Jean-Paul Delfino, l’écrivain-voyageur aux nombreux prix littéraires, qui affirme un goût pour les ancrages populaires, les lieux de friction sociale et de dérive morale. On retrouvera aussi Gilles Del Pappas, écrivain au grand cœur à la gouaille toute marseillaise dont les anti-héros – et en particulier Le Grec –, humanistes, refusent le cynisme et les compromissions des lieux et époques qu’ils traversent.
Enfin, on entendra Maurice Gouiran, lauréat du Prix spécial du jury – Prix de l’Évêché 2025 pour son roman On n’est pas sérieux quand on a 17 ans et Pierre Dharréville, ancien député communiste des Bouches-du-Rhône, également romancier. Ce dernier, décidément homme aux multiples talents, proposera un moment musical autour de Louis Aragon et présentera le disque qu’il a réalisé avec le musicien Christian Vaquette, qui met en musique treize textes du poète, certains célèbres, d’autres moins connus du grand public. Avec des sonorités pop-rock, cette pépite offre une relecture contemporaine d’une œuvre aux textes intemporels.
ANNE-MARIE THOMAZEAU
Noël en culture
12 et 13 décembre
Les Rotatives La Marseillaise, Marseille
Entrée libre
Retrouvez nos articles Politique culturelle ici