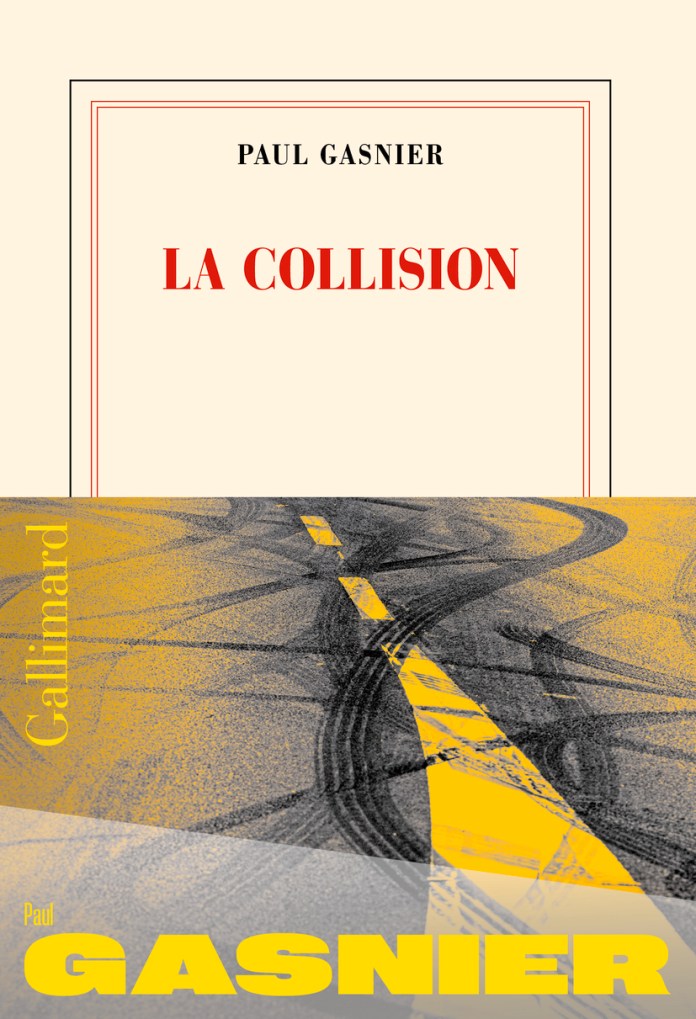L’été touche à sa fin mais pas question de renoncer aux derniers rayons de soleil. Vendredi 29 et samedi 30 août, le festival rock indé La Guinguette sonore revenait pour une huitième édition avec une programmation féroce sur la plage de la Romaniquette à Istres.
Comme souvent pour ce rendez-vous, la scène locale est mise à l’honneur, le groupe Le Bien, originaire de Marseille, ouvre le bal. Le quatuor invite au lâcher prise avec une sonorité punk férocement entraînante. L’atmosphère joyeusement électrique – malgré la panne de courant – est de plus en plus palpable avec le passage de Crache, et son énergie fulgurante tout droit sortie de l’underground marseillais. Le lendemain, on appréciera aussi le groupe lyonnais Irnini Mons, entre grunge et pop, dont la performance était traduite en chansigne.
Inclure et partager
Car pour cette édition encore, le festival promeut l’accessibilité pour tous, avec notamment deux nouveautés dont la mise à disposition de gilets vibrants pour les personnes malentendantes et la venue de chansigneurs. Un travail mené avec la ville d’Istres, dans le but de « rendre le festival de plus en plus accessible et inclusif ». Une initiative qui devrait être « réitérée les prochaines années » selon Nathalie Ferry, responsable des actions satellites sur le festival.
THIBAUT CARCELLER
La Guinguette Sonore s’est tenue les 29 et 30 août sur la plage de la Romaniquette, Istres.
Retrouvez nos articles Musiques ici