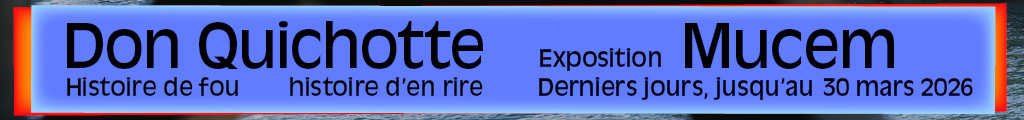Six jours, c’est la durée de la Création biblique du monde. Pour Joachim Lafosse, si ce qui se joue dans cet intervalle est plus modeste, c’est tout aussi fondateur. Une semaine de vacances un peu particulière, gravée dans ses souvenirs. Ce printemps-là, sa mère désargentée, séparée d’un homme issu de la riche bourgeoisie, passe en cachette quelques jours avec le réalisateur-enfant et son frère jumeau dans la maison de ses ex-beaux-parents, où elle n’a plus le droit d’aller. Pour lui, c’est la prise de conscience de la fragilité économique de cette mère aimante et vaillante.
Pour son 11ème film, le réalisateur belge reprend ce souvenir personnel et réécrit le scénario avec Chloé Duponchelle. Un scénario qui prend en compte cette prise de conscience filiale mais surtout, raconte celle de Sana, la mère, incarnée par Eye Haïdara, qui va gagner en quelques jours le sentiment de sa légitimité.
Le leitmotiv de Sana, c’est « on se dépêche les garçons, je vais être en retard ». Elle est seule avec Raphael et Thomas (Leonis et Teodor Pinero Müller) dans un petit appartement. Elle enchaîne les boulots, commence avant le lever du jour, s’arrête bien après, tout en veillant au confort et à l’éducation de ses garçons. Pour les congés de printemps, elle les emmène à Lyon, où elle doit rejoindre Jules (Jules Waringo) leur ancien entraineur de foot, devenu son amant à l’insu de tous. Mais Jules n’a pas un logement assez grand pour les accueillir. Pressée par ses fils, elle accepte d’aller s’installer dans la résidence secondaire des grands-parents paternels à Saint Tropez.
Jeux de société
Elle a encore le code de l’entrée du lotissement (où résiderait Rihanna) et les clés de la maison, toujours vide à Pâques. Les voilà, résidents clandestins de cette somptueuse villa avec vue sur la mer, piscine et jardin arboré. Il ne faut pas se faire remarquer, ne pas utiliser l’électricité, ni l’eau, ne pas se montrer dans les clubs ni les plages privées. « On n’a pas le droit d’être là » martèle-t-elle à Jules et à ses fils. Illégitime dans ce fief, par son nouveau statut de divorcée, retrouvant peut-être le malaise d’une mésalliance et d’humiliations passées. Sous la chronique des vacances de rêve à St Tropez, faite de petits gestes, de petits riens, de la joie des ébats dans l’eau, de pêche au poulpe dans des criques désertes, de jeux de société à la lumière des bougies, se crée une tension. Maintenue à la fois par la crainte d’être découverts et chassés, mais surtout par un hors champ présent et passé où s’écrirait une histoire qu’on ne fait que deviner. C’est cette histoire-là qui finira par éclater avec un dernier geste de panache et de dignité de Sana assumant enfin pleinement son droit à l’amour, aux plages publiques et au bonheur. Pour elle et ses fils.
ELISE PADOVANI
Six Jours, ce printemps-là de Joachim Lafosse
Les Films du Losange
En salles, le 12 novembre