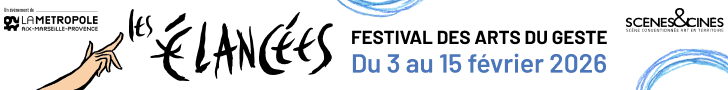Nombreux furent ceux qui regrettèrent, en quittant l’exposition dédiée à Baya donnée à l’Institut du Monde Arabe, puis en version augmentée à la Vieille Charité, que la vie et l’œuvre de l’artiste n’aient pas donné lieu à un catalogue argumenté. Un travail d’une telle ampleur, forgé en pleine adolescence entre Algérie en pleine émancipation et France de l’après-guerre, méritait un tel développement. Voilà chose faite avec le très beau texte d’Alice Kaplan, rédigé au fil de conversations poussées avec l’entourage de l’artiste algérienne, et au contact de nombreux fonds, dont ceux des Archives nationales d’Outre-Mer d’Aix-en-Provence.
On y découvre ce que la vision seule des sublimes tableaux de la peintre, et même le travail muséographique pourtant conséquent des lieux d’exposition, n’avaient qu’esquissé. La misère dans laquelle l’enfance de Baya se déroule – « le froid, la faim, les poux » répètera-t-elle pour décrire ses années passées chez sa grand-mère après la mort de ses parents. La rencontre déterminante, à l’aube de ses dix ans, avec Marguerite Caminat, épouse d’un artiste, Frank McEwen, qu’elle délaissera peu à peu pour faire connaître le talent de sa jeune protégée. Avant qu’une série de soutiens, souvent féminins, ne la prennent encore sous son aile. Mais aussi la prégnance de rapports coloniaux : avant de se faire connaître, Baya, à peine pubère, officie comme bonne chez la plupart de ses bienfaiteurs ; une fois de retour dans une Algérie en pleine lutte, elle cessera de peindre pour se contenter de son seul rôle d’épouse ; avant de revenir à son art, au lendemain de la décolonisation, loin de l’effervescence parisienne et européenne qui l’avait fait connaître.
Le sens du récit
L’historienne et universitaire américaine, enseignante à l’Université de Yale, ne s’est évidemment pas contentée de lister doctement les faits et gestes de la jeune peintre. Une cinquantaine de pages de remerciements et de notes en fin d’ouvrage atteste de la véracité de son récit, y compris dans ses spéculations et ses questionnements. Mais c’est bien dans sa volonté de regarder les œuvres de Baya, présentes tout au long du texte, de les lire et de les comprendre à la lumière d’une telle vie, que le travail d’Alice Kaplan se révèlera le plus émouvant. On savait, depuis son travail sur Albert Camus mais surtout depuis son roman paru au Bruit du Monde en 2022, qu’Alice Kaplan possède un sens inné du récit, un regard et même un style particulièrement affûtés. Sa complicité avec son traducteur Patrick Hersant transparaît d’ailleurs dans son phrasé même, d’un lyrisme tout à fait raccord avec la dimension si romanesque d’une telle destinée.
SUZANNE CANESSA
Baya ou le grand vernissage, d’Alice Kaplan
Traduit de l’américain par Patrick Hersant
Le Bruit du Monde - 23 €