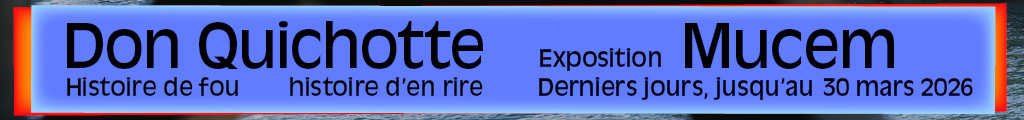Le Stabat Mater, poème médiéval, évoque la Vierge Marie debout face à la croix, contemplant la souffrance de son fils crucifié. Texte liturgique par excellence, il a inspiré les plus grands compositeurs – de Vivaldi à Arvo Pärt – qui ont cherché à traduire en musique cette tension entre douleur et dignité. C’est cette verticalité, ce corps meurtri mais érigé qu’Ana Pérez et José Sanchez ont voulu exprimer à la puissance du flamenco. Les deux artistes ont développé cette recherche pour trois danseuses, un chanteur et un guitariste.
L’ambition était de faire dialoguer les époques et les esthétiques, « tisser une architecture vivante où les matières sonores, les rythmes, les chants et les gestes se répondent ». Sur le papier, l’idée était louable. Le mélange des genres – baroque, flamenco, sacré, profane – aurait pu constituer une immense réussite. Sur scène, la réalité s’avère contrastée.
Le spectacle débute pourtant sous les meilleurs auspices. Les trois danseuses, le chanteur et le guitariste forment un cercle devant un point de lumière, entonnant un Stabat Mater tout à fait convaincant. Le texte – réécrit en français puis chanté en espagnol –, la musique qui convoque à la fois Pergolèse et Purcell, témoignent du cosmopolitisme baroque européen. On découvre avec bonheur que les danseuses possèdent de magnifiques voix, capables de se fondre en polyphonie. C’est beau. Les danseuses sortent alors de cet espace liturgique en frappant du talon, scandant le temps qui passe comme des battements de cœur ou des taureaux dans l’arène qui s’apprêtent à charger. Le flamenco entre en scène. C’est encore captivant.
Et puis quelque chose se délite. Le spectacle bascule dans une succession de solos de bravoure, sans qu’on ne parvienne à en saisir la cohérence narrative. Il est bien sûr question de violence, de colère, de souffrance jusqu’à l’épuisement, de folie… De femmes rebelles, résistantes, debout. Certains tableaux sont magnifiques. Ana Pérez, en grande prêtresse, est divine. Sa présence magnétique, sa maîtrise technique, son rapport charnel à la danse écrase le plateau. Mais cette superbe isole les autres interprètes. Miranda Alfonso, pourtant puissante, semble empruntée, Marina Paje,gracieuse, ne parvient pas davantage à s’imposer. Pourtant, lorsque les trois danseuses dansent ensemble et qu’elles sont connectées, que leurs pieds et leurs regards se répondent, c’est sublime. Ces rares moments de communion révèlent l’intensité que la soirée aurait pu atteindre.
Mais l’ensemble reste décousu. On ne comprend pas l’accoutrement du guitariste, affublé d’une étrange jupette évoquant l’Égypte ancienne. On peine à saisir le sens de la scène surjouée où l’une des danseuses tente d’arracher son tambour au chanteur, métaphore de l’accès des femmes au pouvoir sacré, chamanique ? Le propos reste opaque. C’est surtout Alberto Garcia, le chanteur de flamenco, pourtant reconnu dans le milieu, qui déçoit en incarnant le texte en chanteur de charme, avec une théâtralité triviale qui entre en collision avec la dimension spirituelle du propos. Heureusement, la création lumière d’Arno Veyrat, du blanc virginal au rouge du sang, apporte au spectateur une trame salutaire qui aide à se repérer dans cette traversée chaotique.
ANNE-MARIE THOMAZEAU
Le spectacle a été donné le 10 janvier à Klap – Maison pour la danse, Marseille.
Une proposition du Zef, Scène nationale de Marseille.
Retrouvez nos articles Scènes ici