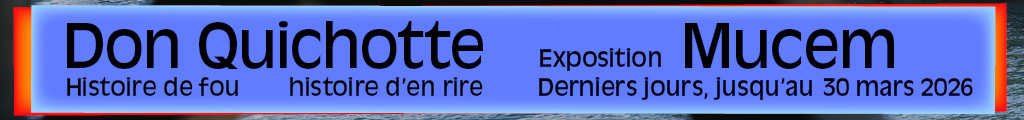Zébuline. Le dispositif Curieux de Nature, qui investit chaque automne un espace naturel différent, franchit un nouveau cap : vous emmenez cette fois vos spectateurs sur l’eau !
Philippe Ariagno. On commence la saison à Savines-le-Lac, avec RicOchets, une balade poétique et musicale au petit matin sur le lac de Serre-Ponçon à bord d’une carline, un bateau rétro. Nous inaugurons avec ce projet – vraiment particulier et symboliquement fort pour nous, en rapport avec un territoire qu’on apprécie –, un compagnonnage de 3 ans avec Ottilie [B], une chanteuse des Hautes-Alpes qui pratique un magnifique chant diphonique. Plusieurs rendez-vous suivront avec cette compositrice, à l’image de 1 + hein ? dès novembre, trois jours de résidence avec David Lafore, suivis d’une performance.
Nouveauté cette année, vous proposez de longues séries sur certains spectacles.
En effet, huit dates pour La saga de Molière, de la compagnie Les estivants, une très belle équipe de la région : Johana Giacardi s’empare du texte de Boulgakov, tout en établissant un parallèle entre une jeune compagnie contemporaine et un Molière qiu rencontrait des difficultés en tournée sur les tréteaux, avant d’être connu. Huit dates sont aussi prévues pour De bonnes raisons, un spectacle de cirque par la compagnie La Volte qui aborde le rapport au risque, la nécessaire confiance qu’il induit, ce qui advient lors de la chute éventuelle… Cette programmation est intégrée au parcours des Olympiades culturelles.
Cette saison est aussi largement féminine !
Plus de la moitié des projets est en effet portée par des femmes. Certaines sont des fidèles, telle Maëlle Mays qui propose une nouvelle Leçon impertinente de Zou. Une autre révélation : Leïla Ka, qui fut danseuse chez Maguy Marin. Nous l’accueillons lors de deux soirées, la première autour d’un triptyque qui aborde la notion d’identité, ce qu’on est et qu’on doit être, la frustration de n’être que soi… La deuxième autour de Maldonne, sa nouvelle création. On y retrouve notamment Jane Fournier Dumet, une danseuse qui jouait dans le solo Bien parado de La Méandre. Au rayon théâtre, Estelle Savasta adapte L’endormi, un texte coup de poing de Sylvain Levey, étayé du flow de Marc Nammour, leader du groupe La canaille : de l’excellent rap à hauteur d’enfants, dès 9 ans. Vient ensuite L’affolement des biches, dans lequel Marie Levavasseur, que nous avons accueillie sur toutes ses précédentes créations, se frotte pour la première fois à du spectacle tout public. Avec la douceur et la finesse qu’on lui connaît, elle y aborde la mort, le deuil, la manière de se reconstruire après la disparition de ceux qu’on aime.
Ces autrices s’emparent aussi de violents sujets sociétaux.
Notamment avec Le jour où j’aimerais pour la première fois sans toi de la compagnie Vertiges, basée à Nice. Après un premier solo de danse aux accents autobiographiques, Alexandra Cismondi y raconte l’histoire d’une famille, qui commémore la mort d’une de ses sœurs advenue lors d’un massacre dans un lycée. Il s’agit d’un texte étonnant, qui prend place dans un futur proche plutôt dystopique. C’est très particulier, le langage n’est pas le même pour les générations, qui ont du mal à communiquer entre elles… Une petite bombe, les collégiens et lycéens adorent ! C’est aussi le cas avec Les femmes de barbe bleue, une relecture du conte de Perrault, dans laquelle les femmes assassinées prennent la parole pour évoquer les arcanes du désir féminin, le mécanisme à l’oeuvre dans les relations toxiques, la figure ambigüe du prédateur… Il s’agit de se libérer des modèles archaïques qui gouvernent nos inconscients, de chercher à reprendre le pouvoir sur ses désirs. Le tout est porté au plateau par une belle sororité entre les actrices qui s’entraident et s’écoutent.
ENTRETIEN RÉALISÉ PAR JULIE BORDENAVE
La Passerelle
Scène nationale de Gap
theatre-la-passerelle.eu