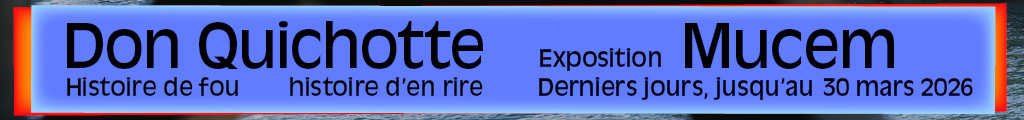L’événement majeur mêlant hip-hop, rap et graff revient pour une troisième édition du 30 août au 2 septembre. Hip-Hop Non-Stop continue de se développer et propose quatre jours de festivités gratuites afin de mettre en lumière les cultures urbaines de Marseille. Le festival se déroule au Théâtre Silvain (7e) avec la seule soirée payante autour de Rim’K mais aussi, gratuitement, l’esplanade de la Major (2e) pour une séance ciné, sur la Plaine avec les lauréats d’un appel à candidature, ou pour la première fois, lors de sa soirée de clôture, au sein de la Cité des arts de la rue (15e). Cédric Claquin, directeur opérationnel d’Urban Prod, compagnie à l’origine de cet événement, revient sur la programmation de cette nouvelle édition.
« On essaie de proposer des choses qui nous font plaisir » explique-t-il. « L’année dernière on était un peu déçu de ne pas avoir pu développer plus de graff, l’équilibre entre les trois principales disciplines doit être respecté et c’est selon moi chose réussie pour cette édition. »
Des critères divers
« On souhaite jouer avec la curiosité des festivaliers et de ne pas être dans la surenchère des têtes d’affiches. On propose de nouvelles découvertes artistiques à ceux qui ont cette curiosité de venir voir ce qu’il se passe ». Et d’ajouter : « on essaye aussi de mettre en avant des personnes de quartiers populaires ou exilés de leur pays, sans avoir à transiger avec la qualité artistique. »
Autre ambition, et pas des moindres quand on parle d’un milieu du hip-hop très masculin, la recherche de la parité femme-homme. « À ce sujet, je suis satisfait de là où on en est. Sur les 42 artistes programmés, 21 sont des femmes donc on peut dire que l’objectif est accompli. Quand je vois que de gros festivals ne font que 15% je suis satisfait de notre travail. »
Des attentes
Avec cette nouvelle édition, Cédric Claquin entend donner une place plus importante à la danse, car pour lui « il faut réconcilier le rap et la danse ». Une volonté qui se traduit avec l’invitation de la compagnie Hylel et son spectacle Bach Nord, « une réponse directe à l’image renvoyée par le film de Cédric Jimenez Bac Nord ».
C’est d’ailleurs dans le 15e arrondissement, au sein de la Cité des arts de la rue, que la soirée de clôture se tient. « Ce n’est évidemment pas un choix anodin. On a cette volonté de se rapprocher des quartiers Nord pour donner envie aux jeunes de venir voir ce que nous proposons. » Avec l’espoir que « le public habitué au centre-ville soit lui aussi au rendez-vous. »
BAPTISTE LEDON
Hip-Hop Non-Stop
Du 30 août au 2 septembre
Divers lieux, Marseille
hiphop-nonstop.fr